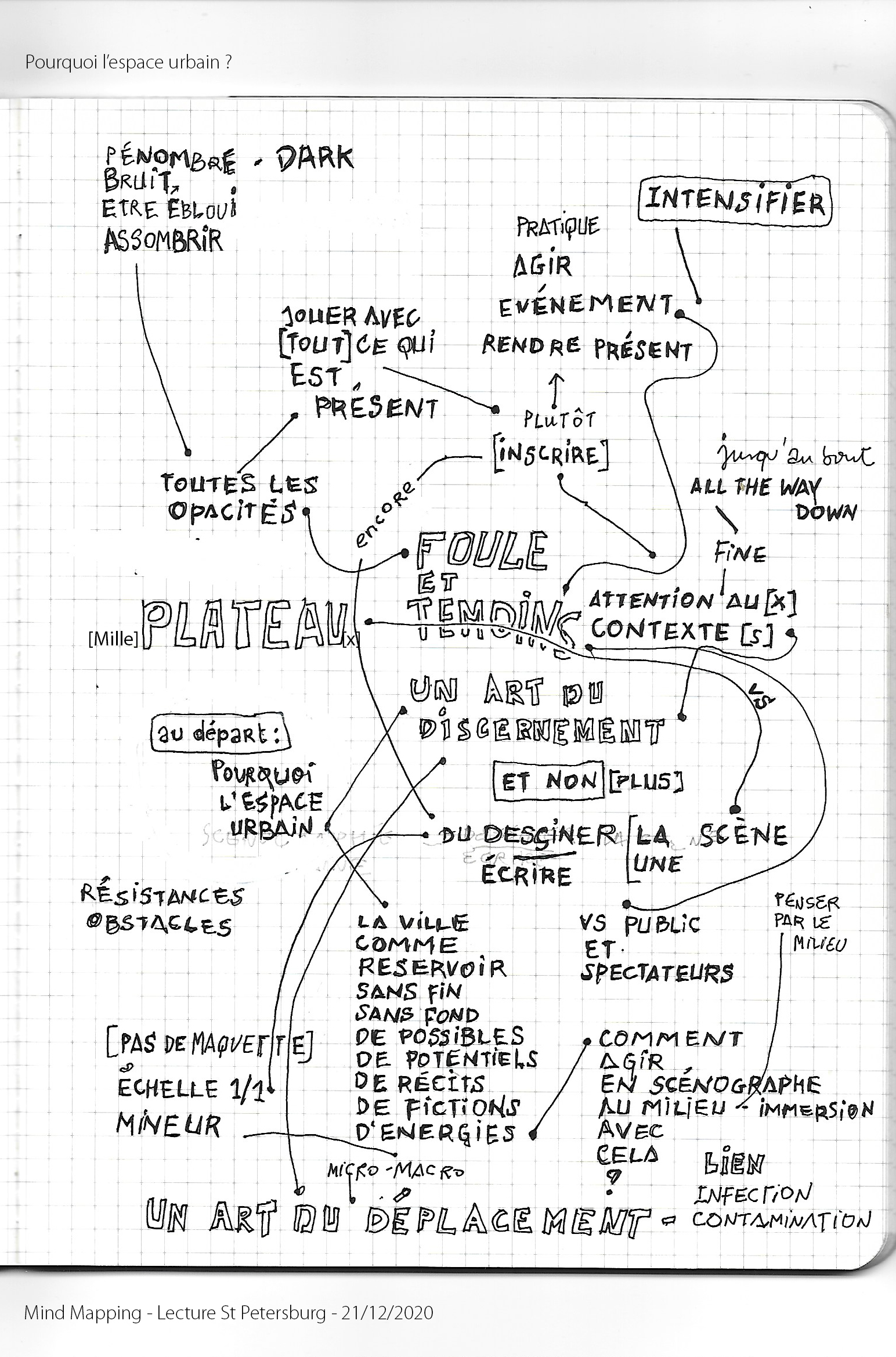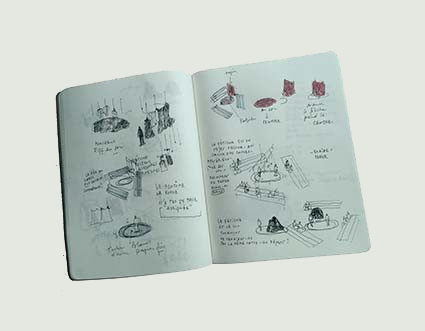
Notes scénographiques
Cette page est consacrée à de brefs écrits scénographiques, la plupart postés sur Facebook. Voir ICI.
Courtes esquisses théoriques, fragments d’une réflexion plus large, liens vers des textes publiés. Certains textes présentent un projet. L’écriture théorique nourrit ma pratique de scénographe et d’artiste, et vice-versa. J’espère que mis bout à bout ils résonnent sans trop se répéter.
02/02/26
Mon travail d’artiste et de scénographe est profondément contextuel, imprégné des esthétiques de la socialité là où il s’invente et s’inscrit. Les gestes, et les réponses esthétiques sont pour cette raison extrêmement divers. A la longue il y a des récurrences, mais au départ il s’agit d’une situation, d’un milieu. Et d’une réponse simple et réalisable en dialogue avec cette situation.
Il y a aussi une distance par rapport à la représentation, ce qui n’empêche pas le geste artistique. Mais dans les « Mondes suds » (Sony Labou Tansi) où j’ai travaillé et travaille, la représentation n’est pas le seul médium d’expérience pour les gens. Tous les gestes esthétiques singuliers, performatifs, dans leur relation au milieu, sont porteurs de sens, racontent, suggèrent, évoquent. Le champ des possibles est immense et non séparé de la vie. Il ouvre à l’expérience, au-delà des questions de compréhension car tout le monde comprend, se fait une histoire.
25/10/23
La scénographie hante la rencontre (à l’Atelier Scénographie de la HEAR, avec Olivier Marboeuf), il n’est pas scénographe mais les connexions se font. Une en particulier : faire scénographie sans forcément faire scène. Il utilise pour cela les pièces d’un appartement où le salon serait la partie visible, en lumière, alors que la chambre, la cuisine, le cellier seraient les espaces cachés, où pourtant il se passe des choses essentielles en continuité avec le salon. Des choses invisibles. C’est une autre manière de parler de la coulisse, mais c’est aussi une manière de parler du temps long du travail de création et de la vie, de ses moments cachés, protégés, de ses moments à ne pas montrer, dans tous les sens du terme (in-montrable car trop intime, à garder caché, etc.). Ce déplacement du terme scénographie, Olivier le comprend bien, comment jouer, penser à partir d’un terme, en rendre polysémiques les usages.
25/10/23
19/09/23
Le travail de plateau reste exigeant car il faut aller vite, la salle tu ne l’as que dans un temps limité, loin de l’hésitation nécessaire à la recherche création. Cela pourrait durer des semaines tant chaque détail devient alors questionné dès qu’il apparait. Je pense la scène dans une logique installative et performative, ce n’est plus un décor qui la fait autre, les éléments sont avant tout performés, mis en geste, souvent mineurs et furtifs par les corps (j’aime travailler avec la danse et la performance tant la plupart des acteurs restent accrochés au texte et au jeu), c’est ainsi qu’ils font dramaturgie, visions, récits, sens. Le plateau est indispensable, il est le laboratoire, l’atelier, c’est là quand les choses apparaissent que cela se déploie. Avant, autour, il reste tant d’hésitations, tant de doutes, ils ne se résolvent qu’organiquement une fois dans l’espace et dans le temps d’un processus qui agit par lui-même, installe le geste souvent sans même que tu t’en rendes compte. J’aime intervenir par petites touches et regarder les choses se faire, apparaître, devenir évidentes au fil du temps, tu oublies ainsi tes méandres, les pistes se perdent, le geste se fait simple, à la fois structurant et proche de la disparition.
03/09/23
Un texte pour la publication qui fait suite à la résidence des Scénos Urbaines Mayotte.
Les quartiers sont avant tout des lieux de vie. Urbain, pas urbain, public, pas public, bidonville ou gentrifié, riche ou pauvre, loin ou près, sale ou propre, aménagé ou non, mixte ou non, des lieux de vie. La vie y est ce qu’elle est, souvent difficile. Mais cette infrastructure de personnes est ce qui fait une ville. Le reste vient après. Quelles pratiques, quelles dynamiques, quelles énergies, quelles tensions, quelles joies, quelles difficultés. Cette entrée ouvre sur une autre, finalement assez radicale tant elle est peu prise en compte : les gens savent comment ils veulent vivre, dans quels espaces, des espaces qui correspondent aux relations qu’ils tentent, souhaitent entretenir les uns avec les autres, ont, entretiennent, endurent, inventent, négocient. Ils savent et ils sont en mesure d’aménager. Dire cela c’est simplement prendre acte de l’existence des intelligences collectives, de l’intelligence des corps, des vies, des aspirations. Ce qui est troublant, inquiétant, dangereux même, c’est le peu de prise en compte de ces savoirs dans les politiques urbaines. A la Vigie ces savoirs sont flagrants. Les espaces sont certes faits de peu, de ce qu’on a, autour de cours, d’arbres, mais ils sont là, centrés sur la parcelle, l’intérieur. Ils sont bâtis souvent au détriment du commun (de l’espace public), mais malgré tout les signes y sont nombreux d’attention, d’entretien. Dire « c’est un bidonville » est une manière de ne pas voir cet urbain complexe, difficile à vivre tant, en l’état, les infrastructures manquent, tant il y a à faire pour que la vie des gens soit regardée, prise en compte par l’Etat, par les communes… Cet urbain précaire est appelé bangas à tort, pour dire bidonville, habitat précaire ; et à raison parce-que dans sa forme construite il reste en lien avec le banga, habitat traditionnel et parce-qu’il est porteur de possibles dans sa légèreté, sa simplicité, sa manière « économique » de se poser et de bâtir un (mi)lieu de vie. Ces quartiers sont aussi des conservatoires de connaissances et de pratiques, il recèlent des modes de vie anciens, des lores, des modes de vie qui perdurent et disparaissent, mutent à tout le moins, qui pourtant sont toujours là. Ce qui ne manque pas d’interroger quand on sait les mutations climatiques, le danger de ce qui est en train d’arriver, vers lequel nous allons insouciants et auto-aveuglés en construisant à contresens écologique, sous prétexte que le béton est signe d’une modernité espérée, comme ailleurs, comme en métropole. Mais ce n’est pas le fait propre de Mayotte ou d’Anjouan, c’est le fait de partout, du monde, un modèle de vie, de ville, de construction, dont on se revendique car il constitue l’idée d’une vie meilleure, alors qu’il est un désastre qui vient.
Les Scénos Urbaines s’installent dans des quartiers. On nous le reproche souvent, durée trop courte, esthétiser la misère, attention portée aux migrants alors qu’on délaisse ceux qui payent leurs impôts… J’en passe. Et aussi, oui je sais, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne comprends rien, je n’ai pas de difficultés dans ma vie, je ne vis pas là tout le temps, je, tu/vous, ils… Quoi ? Les Scénos c’est vivre un mois, situé, en (aussi complète que possible – la clef) collaboration avec des artistes locaux. Ce sont eux qui rendent possible le projet. Elles se connectent aux pratiques des gens, elles aspirent à la joie et au commun, à des gestes de vivre ensemble et de gratuité. Elles ne demandent rien en contrepartie, rien à signer, pas besoin d’être membre d’une église évangélique, de voter, de faire allégeance. Juste participer si on le souhaite, ce qui veut dire passer une tête au dessus d’une palissade quand le bruit dehors est inhabituel, quand la routine est perturbée, quand un danseur fait l’anaconda dans la poussière, quand il chante. Passer une tête, écouter de loin, regarder en passant, venir voir, oui, c’est étrange et cela ne fait pas « un public », un public ça fait expérience « sérieuse », posée, assise, attentive… d’un geste artistique. Ah bon. En êtes vous sûrs ? Les Scénos ne formatent pas, ne cadrent pas, surtout pas (du moins c’est ce qu’elles tentent). A quel point dans les pratiques d’artistes, créer reste un geste de cadrage, ou de décadrage, un geste structuré avec ou contre un cadre ? A quel point c’est si profondément inscrit qu’il est difficile de penser des gestes poreux, sans cadre, sans limites, qui fuient ? Un manque de lisibilité, dira-t-on. Les Scénos ouvrent avant tout un espace d’inter-relation avec des gens, leurs (mi)lieux de vie, elles invitent à regarder ces (mi)lieux pour ce qu’ils sont, de vie, sociale, esthétique, culturelle, matérielle, vie avant tout. Elles invitent à la gratuité et à la joie. On ne le répètera jamais assez, la joie est politique. Elles invitent à des formes, certes précaires et éphémères, de liberté. C’est toujours ça de pris dans le long continuum des humiliations et des galères de la vie. Elles invitent au commun.
Les pratiques et les gestes des artistes invités sont en prise avec cela. Il faut bien admettre qu’aujourd’hui encore, être un artiste qui s’imprègne et regarde autour de lui, qui ne parle pas d’abord de lui, reste un peu rare. Accueillir le monde, les lieux où l’on se trouve, les gens, la pratique d’autres artistes, n’est pas si fréquent. J’exagère, le monde change vite, les pratiques collaboratives se développent, mais si j’exagère c’est parce-qu’à chaque résidence des Scénos cela reste un défi pour chacun de nous, d’ouvrir nos pratiques de la scène, de la peinture, de la danse, de la photo, de la performance, à ce qui nous entoure, comment aller aussi loin que possible dans une construction à partir, avec, en dialogue, en tension avec ce qui nous entoure, sans pré-supposés, sans idées arrêtées, en écoutant, en regardant, en marchant, en déambulant, en discutant…
J’écris ce texte le matin où nous quittons définitivement la grande maison en béton avec terrasse couverte d’une charpente en bois, qui nous a servi de lieu de vie collectif. Juste à côté, le chantier d’une maison en béton dont on ne sait pas à quelle hauteur elle montera. Des ouvriers, probablement sous payés, probablement sans papiers, creusent un trou. Cela a duré tout le mois et cela va continuer. Les premières semaines c’était à la pelle et à la pioche, depuis 15 jours c’est au marteau piqueur. Plus loin une tronçonneuse coupe un arbre, fait disparaitre un peu plus la forêt que fut cette colline. On coupe, on tranche, on délimite, on organise. Le trou s’agrandit, il fait déjà 10 mètres de profondeur, il est dantesque et chaque jour les ouvriers reviennent, cassent la pierre, excavent. Jusque-où ? Nous avons évidemment demandé à quoi sert ce trou.
C’est une fosse septique, nous a-t-on répondu.
11/04/23
Le geste scénographique ne serait-il pas fondamentalement de mettre de l’ordre sur la scène. Le cadre jouant ce rôle dans le champ de la représentation. Cadrer c’est organiser et dit Castellucci, c’est aussi le geste fondateur de l’Occident, auquel le confronter précise-t-il. En cela, une dimension coloniale sous-jacente (colere : designer, cultiver > De Boeck, Suturing the City, 36). Evidemment le geste scénographique sur une scène fait partie d’une pensée du monde, occidentale, qui a sa propre cohérence, et qui entre autres, colonise. Le geste scénique n’est donc pas toujours en soi colonisateur. Quoique ? Si ordonner, classer, organiser sont ces gestes fondamentaux, alors il existe une zone grise à creuser. Mais lorsque je travaille dans un contextes non européen, avec des artistes des Suds, disons ‘africains’, alors ce geste, les lieux dans lesquels il est posé, prennent une autre résonance. La question d’organiser se fait plus tendue. Et il suffit pour cela de voir à quel point dans l’étude Noire cet enjeu est central. Comment échapper à cette organisation, inventer autre chose (Mudimbe, Moten…). C’est explicitement ce qui a été en travail avec Sello Pesa et Boyzie Cekwana, et actuellement avec Nadia Beugré. Comment non pas tout désorganiser, mais disons, organiser autrement. Ca veut dire quoi, concrètement, autrement. C’est aussi par ex., l’enjeu de l’expo Kinshasa Chroniques.
31/12/22
Je construis des petits théâtres. Pour des projets d’artistes, écrivains, danseurs, performers, metteurs en scène. S’ils sont simples ce n’est pas faute de moyens. Ils inventent des scènes… sur des scènes [ou ailleurs]. Vous ne le verrez peut-être pas tant en apparence ils ne poussent aucun retranchement mais en les dessinant je les imagine qui mettent en péril, du moins fragilisent les repères acquis d’occupation de la scène, qui déplacent la relation attendue : ils tremblent le dispositif de représentation, la distance connue, la vision claire. Je fais cela à bas bruit, ils sont gestes-espaces mineurs. Ils ne revendiquent pas, ils restent en apparence ‘dans les clous’ par nécessité pragmatique et pour ne pas embarrasser les artistes qui s’en emparent. Car si je me montre trop dé-dé-dé… alors la machine à formater va se faire plus pressante. Mais sachez cependant que dans ces petits théâtres on peut, si l’on veut, deviner le murmure ou le cri de paroles invisibles et secrètes, importantes et libres, car ils ouvrent à l’expérience du divers. Et sachez aussi que je vais la pousser, l’explorer plus avant, la radicalité discrète des ces petits théâtres qui sont… différence sans séparation.
04/12/22
Notes pour Up There – Création de Wael Kadour et Mohamad Al Arashi. Ou comment une équipe artistique syrienne créé à Mulheim Am Der Ruhr, un spectacle qu’elle aurait voulu créer à Damas. Lire ICI
05/06/22
De Kinshasa Chroniques à la Bibliothèque – Un texte hommage à Dominique Malaquais, sur notre travail en commun pour l’exposition Kinshasa Chroniques (MIAM Sète et Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris – et sur la transmission de sa bibliothèque) : TEXTE MULTITUDES jc lanquetin
25/10/2021
Difficile de trouver les mots lorsque une complice et amie aussi proche vient à disparaître.
Dans le cadre du programme de recherche Play>Urban, les résidences des Scénos Urbaines et dans des projets plus personnels, nous travaillons depuis le milieu des années 2000 avec Dominique Malaquais. C’est à Douala que la connexion s’est faite par l’intermédiaire des artistes du Cercle Kapsiki, Hervé Yamguen et Hervé Youmbi. Dominique a publié un texte parlant des traces immatérielles de la résidence, laissées chez les habitants du quartier de New Bell, où elle s’était déroulée. Ce texte a été essentiel à la constitution même du projet, car il répondait d’emblée à une question depuis récurrente : quelles traces (sous entendu, tangibles) laissez-vous une fois partis ? Ce à quoi les habitants répondaient fort bien : on a envie d’autres projets, d’autres événements, on a envie que notre quartier vive.
Nous nous sommes alors rencontrés à Paris. Ce fut important car à ce moment là, 2005, les débats en France étaient le plus souvent simplistes et ignorants, encombrés de clichés coloniaux, en ce qui concerne la relation aux sud[s]. Elle était alors l’une des rares en France avec son bagage venu des Etats Unis, son parcours, son expérience des contextes, à pouvoir porter un regard aussi précis, radical ET nuancé, sur les possibles d’une relation avec les contextes africains en particulier, que nous découvrions encore, et pour lesquels notre intérêt était souvent caricaturé.
Nous l’avons donc invitée à Strasbourg, à la HEAR, l’école d’art où nous enseignons la scénographie et où nous tentions déjà, à l’époque, de faire venir artistes et étudiants non européens, notamment africains, ce qui était et reste un défi constant. Ainsi s’est initiée, avec douceur sur ces sujets pourtant polémiques, une complicité intellectuelle, d’idées, un croisement des regards, beaucoup de questionnements sur les manières d’agir, les pratiques et la place d’un.e artiste ou chercheur.euse européen.ne dans sa relation aux sud(s). Nous nous en rendions à peine compte tant cette relation s’est faite organique. Elle est jalonnée de multiples moments : au fil d’un partenariat entre l’Académie des Beaux Arts de Kinshasa et la HEAR, un long séjour à Kinshasa à l’été 2008 a constitué pour elle l’une des ouvertures sur cette ville. Elle a accompagné la naissance du programme de recherche Play>Urban [à la HEAR toujours], dont elle a contribué au socle théorique en nous faisant notamment rencontrer le travail d’AbdouMaliq Simone et en accompagnant les résidences, à Strasbourg et Johannesburg entre 2011 et 2013, ainsi que la naissance de la revue Play>Urban.
Cette relation a évidemment largement croisé les Scénos Urbaines : elle nous a rejoints à Johannesburg en 2009 et a été co-commissaire du n°14 de la revue Livraison, consacré à une résidence virtuelle à Belleville [Paris]. Les réseaux se sont ainsi croisés, une constellation, bien vivante aujourd’hui, s’est dessinée : Lionel Manga, Julie Peghini, Ntoné Edjabé, Kadiatou Dialo, AbdouMaliq Simone… font partie des rencontres importantes que nous lui devons. Elle s’est mise à écrire et cheminer avec des artistes comme Mega Mingiedi, le collectif Eza Possibles, Kongo Astronauts, Androa Mindre Kolo… Artistes, chercheurs, complices nouveaux, se sont glissés et ont grandi doucement dans nos vies et nos projets respectifs, via cette manière si particulière qu’avait Dominique de constamment faire réseau, de parler aux uns du travail des autres, de faire ‘nous’, de faire du travail commun une force.
Dans un cadre plus personnel, Dominique et J-Christophe ont traduit et écrit ensemble : des textes d’AbdouMaliq Simone, certains textes de J-Christophe publiés dans la revue Chimurenga, notamment sur le travail d’Unathi Sigenu ; un texte sur le collectif Eza Possibles [catalogue Beauté Congo]… La distinction entre les deux se faisait floue tant son rapport à la langue et à l’écriture étaient ancrés et précis. Entre 2017 et 2020, J-Christophe a été scénographe de l’exposition Kinshasa Chroniques, dont Dominique était commissaire [Avec Androa Mindre Kolo, Fiona Meadows, Claude Allemand Cosneau, Sebastien Godret], d’abord au MIAM à Sète, puis à la CAPA à Paris. L’un des dialogues qui constituent sa HDR revient sur cette aventure de plus de trois ans et sur ce qu’implique le fait d’exposer une ville comme Kinshasa – comment porter un regard sans surplomber, comment déconstruire les clichés, amener les gens à faire expérience ‘par le milieu’ -, sur les enjeux d’un tel projet et les [im]possibles d’une radicalité, dans un contexte muséal européen.
Enfin, le projet des Utopies, mené avec Julie Peghini, a connu deux volets : le premier, les Utopies Prophétiques à la Cité Internationale des Arts, à l’invitation d’une autre complice, Bénédicte Alliot, et le second, les Utopies Prophétiques, à la HEAR-Strasbourg, ceci quinze jours à peine avant sa disparition. Malade elle l’était, mais en fait elle ne l’était pas. Elle avançait et nous avancions, tous, avec elle à chaque instant.
Dominique a agi pour nous comme une boussole et ce pendant plus de quinze ans. Elle a guidé, par sa présence, ses écrits, par sa bienveillante intransigeance, ses suggestions, sa radicalité éthique, nos pas, dans une grande partie du travail que nous avons mené. Nous avons agi ensemble, écrit ensemble, infusé ensemble, dans une profonde amitié. Au-delà de chacune des expériences ici évoquées, c’est ce compagnonnage essentiel qui nous reste et qui constitue une perte dont nous avons beaucoup de peine à imaginer comment faire, à l’avenir, sans elle. Mais cela viendra, elle l’aurait souhaité. Nous continuerons donc avec elle, dans ses pas.
Un immense merci, Dominique.
François Duconseille et Jean-Christophe Lanquetin
20/07/2021
La scénographie, une pratique contextuelle, publiée dans Context Conakry, une publication de [Applied] Foreign Affairs, Programme de recherche de l’Université d’Architecture de Vienne, dirigé par Baerbel Mueller. Voir ICI
25/09/2021
A Propos des moments de restitution d’une résidence à Mayotte, dans le cadre du programme de recherche Play>Urban.
Cette forme de dérive, de déambulation lente, d’attente qui se fait immersion dans la ville. Les corps l’occupent latéralement, l’attention est déplacée par les gestes décalés, amplifiés, singuliers, des artistes. Ils font rencontre, ils contaminent les situations ordinaires qui par contraste s’intensifient et se chargent d’une puissance d’étrangeté. Une expo de photos à même le sol génère des échanges, tout comme une maison traditionnelle, un banga, recouvert d’un tissu renvoie à pratiques anciennes et à la ville qui finit de disparaître. Puis vient la projection d’une vidéo sur un mur dans la rue – déambulation nocturne avec des chiens aliens aux yeux fluorescents ; les voitures passent, non loin la police contrôle (fréquent ici). Nous attendons massés sur le côté la nuit qui vient, pourtant en temps normal il n’y a rien à attendre là, c’est juste un fossé. Ces micro déplacements font intensité latérale, tout comme lorsque nous nous massons sur une pelouse près de l’aéroport, de nuit, presque seuls, pour distinguer une danse sur une chanson de Balavoine qui dit la détresse de la solitude, ou lorsque la marche vers la proposition suivante, dans le noir , sur un chemin en tranchée, jusque à la mer (où nous finirons par observer les tortues), se fait danse party douce et furtive. C’est toute la ville qui se pratique autrement, dont le récit ordinaire glisse. Ce qui fait que notre attention, elle aussi, est changée par la lenteur joyeuse de la dérive gratuite et joueuse, l’esthétique, par des détails invus, par des personnes, des situations. La ville est faite d’autres plis.
Je retrouve cette joie collective, énergie de vie qui est celle si souvent traversée lors des Scénos Urbaines. Un théâtre qui est, littéralement, dans la vie, qui n’est pas nécessairement conflit, drame, qui est juste glissement, intensité, au coeur de l’ordinaire, des rythmes du quotidien et dieu sait si ici ils peuvent être tendus. C’est dans cette tension que du possible se raconte, des devenirs, que des histoires souvent tragiques se déplient, se dansent.
10/03/2021
21/12/2020
Je travaille actuellement sur un projet chorégraphique avec Olga Tvetkova et Valentiina Lutseenko. Il doit être présenté, un jour, quand nous le pourrons, à St Petersbourg… Ci dessous un texte qui parle de la difficulté, voire de l’impossibilité à travailler ainsi, à distance. Il a été lu le 21/12/20, lors d’une soirée en ligne à l’Institut Français de St Petersbourg.
Nous sommes le 4 décembre.
Qu’allons nous faire le 21 ? Comment travailler à distance ?
Olga et Valentina filment des lieux dans la ville. Importants à leurs yeux.
Nous skypons, en anglais. Nous cherchons à faire exister des scènes dans ces lieux. Ajouter/retrancher un élément, une lumière, un geste, un objet… Je ne vois les espaces qu’en ligne. Comment m’inscrire ? Que proposer ainsi, à travers un écran opaque ? Que déplacer, intensifier ? Quels espaces ? Je n’ai pas arpenté St Petersburg. A quoi me raccrocher ?
Etre présent me manque. La perception singulière d’un ici et maintenant, la connexion physique avec la danse d’Olga et Valentina, la manière dont je serai affecté. L’insistance d’un possible, que mon corps – lieu de parole, porteur de récits, de géographies, de lectures du monde – ne peut rencontrer.
Nous sommes le 10 décembre.
Nous essayons depuis le mois d’aout. Discussions, échange de documents, d’images, de textes. Cela s’interrompt. Puis reprend. Le projet, au départ, est une performance dansée fin aout 2020 dans les sous sols de l’église Luthérienne de St Pierre et Paul à St Petersburg. Premiers échanges, classiques, images du lieu. L’église a été piscine à l’ère communiste. La machine à imaginaire se met en route. Eglise, piscine, église à nouveau… un lieu, un passé, spiritualité, nage… Tentatives humaines de faire glisser les choses pour changer le monde… trop loin, trop fort. Retour en arrière.
Aujourd’hui, quelle mesure pour nos corps vivants ?
Cette performance devient fantôme.
Travailler l’espace à distance, je ne sais pas faire. J’aimerais, pourtant.
Mais nous voulons tenir le lien, tous les trois.
Je suis coincé à Paris, à Strasbourg. Or, j’ai besoin de vivre, ne serait-ce que quelques jours, dans le contexte, les lieux de la création. Ces moments communs résonnent avec le geste à venir : sensations fugaces, illuminations, associations libres d’instants vécus, sons de la langue russe, mouvements des corps. Ils ancrent un espace scénographique, une fiction pratiquée.
Je repars toujours trop vite.
Mais chaque scénographie matérialise un désir latent, la possibilité de rester, de vivre là. L’environnement créé est un monde possible, suspendu. Des vies potentielles matérialisées l’espace d’un instant.
C’est un outer-monde, un autre chemin. Ces mondes accompagnent ma vie. Ils la scandent. Mondes flottants. Où que je sois, je côtoie un ailleurs. Kinshasa, Johannesburg, New York, Damas… Des villes, des rencontres, des vies possibles.
De plus en plus il s’agit d’art-action, d’attention éveillée, all the way down, et non de représentation. Un art du discernement, plus que du dessin.
En attendant, à quoi me raccrocher ? Aux sensations fugaces lors de nos échanges ? A google street view ? Aux amis, Anton, dont se devine la relation intense à ce pays, la Russie ; Youri, qui parle de l’importance de St Petersburg dans sa vie. Aux visages lors des obsèques de Staline dans le film de Serguei Loznitsa. Aux films d’Hélène Chatelain ? Aux Posts d’André Markowitz, Aux récits de Svetlana Alexeyevich qui me hantent. A Tchekhov, qui hante aussi. Aux contes russes de l’enfance ? A ma relation fantôme/latente à ce monde d’avant 1989, dans lequel j’ai grandi, étudié le Russe au lycée et découvert Paradjanov, Tarkovski. Clichés ? Comment les éviter ? Le faut-il ? Est-ce une direction ? En quoi le fait qu’il s’agisse d’artistes russes est-il plus opérant que d’autres influences ? Peut-on ainsi entrer dans un monde, le ‘comprendre’ ? Je ne le crois pas, ou plus et pourtant je persiste. Vaine tentative mais moteur puissant. Comment se défaire de ce qu’on a toujours fait ?
Je pense aux vidéos d’Apichatpong Weerashetakul. Elles nous relient. Comment se constitue un faisceau commun de sens, un faisceau de déplacements imaginaires qui va rendre un espace tangible ? Je regarde les vidéos d’Olga et Valentina sur Fb, j’écoute les musiques qu’elles m’envoient. Les peintures proposées par Valentina me touchent. La photo d’un monastère… Ligeti. Si beau, si loin aussi.
La possibilité de travailler autrement du fait de la situation m’intéresse, dit Olga. Oui, mais comment faire ? Un faisceau de possibles dont l’émergence est jusque ici empêchée fait-il un projet ?
J’ai de la peine mais je suis patient. C’est être présent qui m’active. Pudique, c’est le toucher/voir qui me rend vivant. Je cherche à ce que l’espace agisse comme un parangolé d’Oiticica. Un royaume, des blocs d’intensité, magiques dans l’instant, une déflagration diffuse. Dans l’espace.
Nous sommes le 14 décembre. Nous continuons.
Ce texte est nourri de [re]lectures récentes : Volmir Cordeiro – Isabelle Stengers – Donna Harraway, ainsi que Jean Genet, Hélio Oiticica.
05/05/2020
Proximité physique des spectateurs
(écrit le 2 mai 2020, après 7 semaines de confinement, alors que tout le monde s’interroge sur la manière de modifier les espaces en lien avec les enjeux sanitaires).
Reorganizing space by drawing through it. Gordon Matta Clark.
On lui accorde une valeur paradigmatique. Comme si elle était la garante de l’être ensemble que nous chérissons, car pensons nous, la situation rend sa perte irrémédiable. La proximité physique comme garante du commun. Pourtant, le directeur de la Comédie Française, dans une interview récente, admet que les sièges sont un peu trop serrés. Dans nombre de salles cette proximité fait question. Je suis grand, souvent mes jambes cognent la rangée devant moi. J’ai à peine l’espace pour mes coudes, mes bras, les bouger sans déranger mon voisin demande une attention. Entrer ou sortir de la rangée met tout le monde au garde à vous. La densité des assises ne viendrait-elle pas d’un autre critère ? Celui de la rentabilité. Mettre le plus de monde possible dans la salle, au détriment du confort et de la visibilité.
L’une des particularités d’une foule, lorsqu’elle n’est pas contrainte, c’est que chacun parvient, dans un espace restreint par la présence d’autres corps, à se ménager un espace. On se touche peu, ou avec précaution, on s’excuse. Chacun construit sa proxémie. Si quelqu’un déborde, le commun se charge de le remettre à sa place. On peut donc se trouver dans une grande proximité spatiale, à quelques centimètres d’une personne inconnue, mais dans une grande solitude physique. Sans contact ou presque. On va jouer avec tous les interstices de l’espace, avec le mouvement des corps. La fluidité est de mise. Dans un gradin, un ensemble d’assises assignent, qui décident de la posture, la distance entre deux corps est d’abord déterminée par les sièges. Certes nous nous adaptons en faisant attention à nos voisins. Mais ce sont autant les sièges qui dictent. Et ils sont souvent trop proches. Une salle pleine est dans l’imaginaire une salle où il y a du monde partout, où il ne reste pas une once d’espace libre. Le succès, son triomphe d’un spectacle se mesure notamment à cela. Tout le monde veut en être, vibrer, voir. Il y a un sentiment de faire corps en commun. De partager l’émotion. Mais est-ce lié à la distance physique. Oui, en partie, du moins quand ce ne sont pas les sièges qui décident.
Il me revient ici que ce sont, au XVIIème siècle, D’Aubignac et Ricoboni qui ont imposé la présence des sièges au parterre des théâtres et leur alignement frontal, face à la scène. Manière de discipliner la foule qui avant cela s’y trouvait debout et avait donc le loisir de regarder sur les cotés, de parler, de bouger… Bref, d’être inattentive à l’action scénique, lui préférant souvent le commun que représentait la présence du public dans la salle en nid d’abeille.
Je ne pense pas qu’avec le covid19 disparaitra la proximité physique entre les corps. Elle reviendra dès que cela sera possible, y compris dans de grandes foules. Car il y a là un besoin vital d’être ensemble, dans une proximité physique et les gens, les foules, savent gérer cela. Par contre, on peut s’interroger sur la proximité imposée par les théâtres, qui n’est pas à mon sens garante de cet être ensemble. En tout cas ce ne sont pas les distances actuelles entre spectateurs qui le sont. Elles étaient devenues une habitude, on ne les discutait pas pour la simple raison que tout lieu pour des raisons d’habitude, d’imaginaire du succès, mais aussi économiques, souhaite avoir un maximum de spectateurs dans ses salles. Mais se posent déjà depuis longtemps des questions sur ces grandes salles de théâtre qui sont vues aujourd’hui comme peu favorables à une rencontre de qualité avec les corps sur la scène (sans parler du fait qu’il faut trouver des spectacles adaptés à ces grands espaces). Au delà de la 20ème rangée, on perd le contact physique avec l’acteur (essayer les dernières rangées du Théâtre de la Ville). De plus en plus de lieux ne montent pas au delà de 600-700 spectateurs et ce sont les jauges plus petites, moins de 300 qui sont les plus appropriées à de nombreux projets. Personne n’a le sentiment de perdre le commun parce-qu’il n’y a que 100 spectateurs dans une salle (sauf si celle-ci a une jauge beaucoup plus importante et que cette limitation ne résulte pas d’un choix). Nombre de metteurs en scène, de chorégraphes sont attentifs à la jauge, ne souhaitent pas qu’elle soit trop importante, car cela nuirait à la qualité de la co-présence. Cet enjeu est scénographique, quoique souvent entravé par la politique et l’architecture des lieux. Il n’est que de voir les négociations menées par les équipes artistiques sur de nombreux spectacles, pour limiter la jauge, ne pas utiliser les places lointaines, dont la visibilité est faible. L’obsession du nombre important de spectateurs a surtout a voir avec des questions financières, de rentabilité, bref avec une logique capitaliste latente (le spectacle vivant ayant une certaine capacité de résistance à la marchandisation). Le fait donc que l’espace entre chacun soit plus large ne me semble pas à priori détruire ce sentiment d’être ensemble. Peut-être y a t’il là une occasion intéressante, et y gagnera-t-on même en confort, donc en qualité d’attention. Peut-être aussi qu’un public reconfiguré en un espace plus grand entre chaque assise, permettra à chacun d’élargir son champ corporel, de ne pas être assis strictement de face. De pouvoir tourner un peu son corps, croiser les jambes de profil. Tourner la tête. Je n’ose dire tourner son siège, car la fixation des sièges au sol est un incontournable des dispositifs de sécurité (je le sais pour avoir essayé de le contourner dans certains projets). Pourtant, lorsque chacun a le loisir de bouger son siège, un confort supplémentaire en résulte. Et donc une attention, celle propre à chacun, au sein d’un collectif, dans une forme d’accord entre la position du corps et la disponibilité de l’esprit. Je réalise aujourd’hui avec cette nouvelle situation, à quel point les gradins ont toujours été des lieux inconfortables pour moi.
Plus encore, cela ouvre un espace pour une réflexion plus large sur une refonte de l’usage des lieux existants. Chaque espace dans un théâtre a en général une fonction assignée et il est difficile jusque ici de les penser autrement que pour cette fonction. Or, souvent dans les discussions au sein des équipes artistiques nous rêvons de déplacer ces usages. C’est une réflexion vite interrompue, car elle se heurtait jusque ici à des refus quasi systématiques (en contradiction souvent avec les grands discours) pour peu que l’on soit un peu ambitieux en la matière. Bref, s’ouvre peut-être un espace qui bouscule l’usage des lieux, les assignations (voir le texte de Langhoff et sa démarche depuis longtemps). Qui ouvre à une forme de décolonisation des espaces. A des jeux de décalage entre usages initiaux et usages actuels. On peut même imaginer que plus la tension serait grande entre l’usage originel, inscrit dans les murs, et les usages nouveaux, plus cela sera intéressant.
Pas sûr donc, que la réflexion qui s’amorce, sur la reconfiguration des lieux scéniques soit vouée à produire un désastre de la co-présence, sauf si elle est laissée au seuls soins des responsables techniques et aux logiques de rentabilité.
Note : Je pense à Brook et aux Bouffes du Nord, cette reconfiguration d’un lieu existant, dont il a radicalisé le commun. Certes les places étaient serrées, mais si l’on met cela de coté, il me semble qu’il y a là une logique à pousser plus avant.
Note 2 : Il y a à Bogota, un petit théâtre classique dont la reconfiguration radicale ouvre à ce jeu contemporain avec les espaces. Il s’appelle l’Espacio Odeon, on en trouve facilement des images en ligne sur leur site – https://espacioodeon.com/
27/04/2020
Brève méditation ou comment ré-interroger l’espace des lieux théâtraux et nos pratiques d’écriture scénique.
Il s’agit au départ de la manière dont la plupart des lieux théâtraux, ici en Europe, assignent à une manière de faire du théâtre et une manière d’en faire expérience. Il s’agit des conditions d’une co-présence et de sa relation au monde. Scénographe, on me demande d’écrire la scène (étymologie de skene grafein en grec ancien) dans ces théâtres. Or écrire sur une scène c’est écrire comme sur une page blanche vide et vierge au départ, c’est y déposer des signes, du sens, c’est la manière dont nous déployons les outils avec lesquels nous questionnons et construisons notre rapport au monde, via sa/la représentation. Cette page, cette scène, découpée géométriquement, est séparée du monde. Et cette découpe reste la condition sine qua non pour que nous puissions parler de ce qui nous entoure. Nous extraire pour écrire et dire le monde. Les théâtres sont les iles de ce geste. C’est l’adn de ces lieux, inscrit dans leurs murs et c’est le noeud de la pratique scénographique classique : réécrire l’espace du monde sur une scène, en écho. Lorsque je relis Yannis Kokkos, (scénographe), il pose clairement cette séparation comme la condition même du théâtre. Cette place du théâtre est une habitude, nous ne la questionnons guère, elle est naturelle (au mieux nous pressentons que quelque chose cloche). Plus encore, elle est notre ‘identité’. Or c’est précisément cette séparation qui aujourd’hui, déjà avant le c19, mais plus encore depuis, dans une résonance bien étrange que je n’arrive pas encore à préciser, ne fonctionne plus. Déjà cela fait des années que dès que je travaille dans un contexte non européen, dans les pays dits du ‘sud’, cette logique insulaire ne tient pas deux minutes. Car en séparant elle introduit une différence qui est un regard sur, un dispositif de pouvoir extrêmement puissant, qui impose et assigne les conditions du dire. Tout le monde ou presque, hors d’Europe, sait d’où vient ce surplomb et cherche à s’en extraire. On peut évidemment bousculer les lieux de l’intérieur (nombreux sont ceux qui le font), mais ils sont si puissants que souvent, le plus souvent je crois, on perd. Or, la question aujourd’hui, ce n’est plus d’abord le fait d’écrire sur, c’est être dans les contextes, c’est d’où tu parles, à qui, pour qui, quand… C’est la nécessité à nous faite de fragiliser les termes même de l’acte d’écrire, les bords de la page, les contextes de la co-présence. Créer ‘sans écrire’ ? Déconstruire cette séparation des espaces tellement naturelle qu’on ne la questionne plus, au profit de processus multiples d’immersions qui nous mettent au contact de théâtralités éruptives, inconsistantes, des puissances subversives et de création qui traversent la vie. Pour un scénographe, c’est inventer les conditions d’une attention non autoritaire autour d’un plateau dont les limites sont brouillées, poreuses, en lien direct, tangible, avec le contexte dans lequel il s’inscrit. Tenter de faire dramaturgie, en prise directe, en déplaçant des corps, des voix, des objets au coeur des contextes.
20/12/2019
Ecrit à Bamako dans le cadre du festival Les Praticables
Quelles esthétiques théâtrales et artistiques, quelles écritures pour un festival dans la ville ? À Bamako, le projet des Praticables se nomme comme la « fabrique d’un théâtre d’art populaire ». Les termes sont à interroger en lien avec le contexte de cette ville, en lien avec une histoire du théâtre ici, bien réelle et depuis longtemps et aussi me semble-t-il, en lien avec ce à quoi ces termes renvoient dans l’histoire du théâtre européen : théâtre d’art, théâtre populaire : quelles formes, pour qui ? C’est une question vivante car il y a ici une aspiration, un désir d’inventer des esthétiques qui mettent en fiction les histoires qui résonnent.
Et puis, il y a l’inscription de la théâtralité dans l’espace urbain… Cela a toujours existé sous une multitude de formes mais cela n’enlève rien au fait que la ville est un réservoir de potentialités, de possibles, à partir du moment où l’on s’éloigne de la référence à l’espace théâtral classique (la boite scénique comme archétype) et si l’on considère le théâtre comme proche de la vie, comme étant la vie. Lu récemment, John Cage qui via Artaud déploie l’idée que tout est théâtre, du moment qu’il est fait appel collectivement à la vue et à l’ouïe. Définition minimale, ouverte, qui a l’immense mérite d’éloigner les conventions, d’ouvrir à l’insoupçonné. La proximité avec le quotidien, la vie qui s’invente comme potentiel de création éloigne le fantôme occidental implicite qui hante dès que l’on pense espace scénique. Nous tentons, à Bamako, de dépasser cette référence latente tout en construisant de réelles conditions pour une écoute et une vision collective. C’est en cela que le projet des chaises est intéressant. Ces chaises tressées de fils de couleur existent partout dans la ville, objet très beau. Un jour en marchant dans la rue, nous imaginons qu’elles peuvent devenir des ‘gradins’ non autoritaires, des assignations souples. Nous, c’est Clara Walter, Siriman Dembele et moi-même. A Bamako les chaises sont de formes, de hauteurs, d’assises différentes et bien sûr la couleur des fils de nylon varie. Ces chaises sont devenues nos gradins. Nous en avons fait construire des dizaines. Clara ajoute que leur présence est amplifiée du fait de l’ajustement de leur forme, de leurs proportions, des accoudoirs, etc. pour les besoins du théâtre. Cette simplicité du geste parle à tous. Les chaises que nous faisons construire sont hautes, sachant que des chaises et des banquettes à 40cm de haut, voire moins, on en trouve partout et que l’on peut ajouter des nattes. Ainsi, 60 chaises hautes font un public d’au moins le double. Ces chaises génèrent un espace qui est à la fois extra-quotidien et en même temps proche de l’ordinaire, qui de déploie partout, dans une cour, dans une rue… Surtout le ‘gradin’ devient variation souple, il se glisse dans l’architecture des parcelles, prend forme organique. Il n’est plus un mur droit, une barre qui coupe l’espace, (demande de Lamine Diarra, directeur du festival). Chacun peut choisir son angle, tourner son siège, inscrire son corps dans le confort d’une attention sans avoir à subir une fixité qui oblige à une direction du regard. Le point de vue n’est plus tant une intention théâtrale que le vécu de chacun. Le jeu entre dramaturgie et expérience s’équilibre. Cette liberté au plus proche des corps me semble essentielle.
En 2015, avec Catherine Boskowitz nous avions imaginé, sur un plateau de théâtre, le public assis, disséminé dans l’espace, avec les acteurs jouant entre les spectateurs, lesquels se tourneraient, voire se déplaceraient. Des chaises déjà. Résistances multiples, mais de toute manière véto absolu du directeur technique. Les chaises auraient dû être vissées au sol. Sécurité.
A Bamako, ce projet des chaises est développé par Ikyeon Park, Marc Vallès, Elie Vendrand Maillet, Cyril Givort (pour les lumières), avec Clara et Siriman et des étudiants en école de théâtre. Elles deviennent l’écriture visuelle du festival. La vision de leurs déplacements et de leur installation ici ou là est en soi une performance qui annonce. La scénographie du festival n’est pas un décor, elle est le mouvement de ces objets, à la fois technique et chorégraphié. Nous sommes accueillis dans un quartier, une rue et alentour, les spectacles s’inventent parmi les gens, le temps des répétitions compte autant que celui des représentations. Pas besoin de décor. L’essentiel s’invente avec ce qu’il y a et chacun sait où cela se passe, les gens vous disent où aller. Les spectacles sont pleins.
La boite scénique est le fantôme glorieux de la scénographie et de l’idée même de théâtre. Une présence inconsciente, implicitement naturalisée. Ceci bien au delà de la sphère européenne (elle n’est pas le seul fantôme, les conventions de jeu, le décor de théâtre ont aussi la vie dure). Cette boîte scénique hante lorsque l’on entre dans une cour et que l’on commence à en imaginer le devenir scénique, à y inscrire de la fiction. Distance, frontalité, cadre (même si invisible) viennent à l’esprit. Grammaire réflexe du scénographe et du metteur en scène. Des acteurs aussi. Elle sert à inscrire des repères connus dans l’espace, repères indispensables, croit-on, à l’écoute du texte, à l’expérience fictive. Mais les cours résistent. Elles ne sont pas si grandes et sont parsemées d’éléments, arbres, objets divers, briques…. Elles suggèrent de penser les directions autrement.
Ce jeu avec les fantômes et le désir de liberté est une tension féconde qui s’expérimente au quotidien, ici à Bamako.
04/11/2019
Ecrit à Conakry, en résidence dans le cadre du Festival l’Univers des Mots.
Agir en créateurs dans un quartier, ici à Conakry, c’est agir sans point de vue, sans perspective. C’est se rendre compte qu’un point de vue est une forme de cécité. Créer ici, c’est avant tout être poreux. Et la porosité ne s’accommode pas de ce philtre, encore de l’ordre de la représentation, d’un regard porté sur, sûr de sa puissance et de sa légitimité, qu’est le point de vue.
Peut-on créer sans point de vue ? D’évidence, oui. Ici, le contexte agit sur nous. C’est peu dire qu’il nous sollicite. Il nous absorbe. Il nous aveugle… Ou nous éblouit.
La vision s’éloigne et l’éblouissement nous rend vulnérable (Joseph Tonda). J’aime cette image, elle me fait penser aux phares d’une voiture qui s’avance vers nous, ce qui arrive souvent ici, et dont les phares diffractent la vision. Ou à un parcours en taxi moto au cœur d’un immense embouteillage, dantesque, la nuit, dans un cheminement non linéaire, comme en spirale parmi les apparitions, les intrusions, les énergies, les dangers.
C’est vulnérables que nous avançons. C’est dans le noir, aveuglés ou éblouis (sans point de vue) que nous pouvons enfin agir. L’espace, les corps, les assemblages, les débordements qui font l’urbain, les énergies si puissantes, souvent sidérantes, infiniment plus créatrices et singulières que nos idées d’artistes, ne cessent d’appeler, de suggérer. Voir ici c’est toucher, constamment, et toucher c’est agir, agencer, être attentif à ce qui nous entoure. C’est aussi, intensément, être dans sa pensée, à l’intérieur de soi, à l’écoute de son -ses- des imaginaires. C’est tout notre corps qui constamment est traversé, travaillé, nous ne surplombons rien, nous ne pouvons que tenter d’entrer dans le flux de cette puissance créatrice collective dans laquelle nous nous trouvons, en y introduisant des écarts, des espaces, des décalages, des respirations, des gestes, même infimes, même de l’ordre de l’invisible ou de l’éphémère, de l’instant. Ces écarts ne sont pas rien. Ils jouent un rôle, mais lequel ? Nous artistes sommes si convaincus de l’importance, du sens, de nos actes… Mais est-ce le cas ? Ou serait-ce plutôt parce que nous sommes noyés dans le tourbillon qu’un espace s’ouvre à nous ?
19/09/2019
Ecrire un livre ? J’y pense depuis longtemps [on me le suggère aussi, parfois], et mon cours théorique à la HEAR – Strasbourg [il s’appelle Esquisses pour une histoire de l’espace de la (re)présentation], en est la matrice depuis longtemps. Ce livre serait une tentative de donner corps à une autre histoire de la scénographie [en commençant par interroger la notion elle-même], histoire qui, à ma connaissance, n’existe pas en tant que telle, mais qui ‘traine’ partout dans la théâtralité d’une multitude de pratiques d’espace, qu’elles soient artistiques, performatives, sociales, quotidiennes, politiques… Ce faisant, il s’agirait de donner consistance à des ‘scènes’ [là aussi, notion à interroger] possibles : comment imaginer, conceptualiser, faire exister des situations, des moments, des co-présences, des expériences partagées entre des performers et ceux dont la présence accompagne le geste, des intensités entre des gens tout simplement, une multitude de variations ‘scéniques’, en lien notamment avec l’ordinaire [on sous-estime beaucoup, en la matière, l’inventivité des pratiques ordinaires]. Des scénographies d’espaces performatifs qui s’inscrivent, se présentent dans un contexte, qui sont le contexte, qu’il soit scénique ou réel, et ce par glissement, intensification, épuisement, opacité, dé-pliage, acuponcture, résistance… des scénographies immergées dans un quotidien ou en retrait dans un espace de condensation plus calme [avec tous les intermédiaires imaginables entre ces deux termes]. Ou : comment penser aujourd’hui les conditions d’une attention qui soit en résonance avec les mutations du monde, non séparée de ses mouvements, un peu éloignée peut-être [une différence mais pas une séparation, dit Fred Moten], ce qui implique de déconstruire [sans pour autant l’abandonner] ce qui constitue le geste historique de la scénographie telle qu’il s’est sédimenté dans la tradition européenne, à commencer par son espace de prédilection, la boite scénique, mais aussi la place centrale du visible sur laquelle se fonde encore l’essentiel de la relation au spectateur, la notion de spectateur elle-même, sans parler bien sûr de la représentation… Je ne suis pas le premier, évidemment, tout cela est en travail en bien des endroits, mais il me semble que cela existe peu du point de vue d’une pratique qui se dédie spécifiquement à la scène.
Dans son mouvement de dé-re-construction, ce livre mettrait en évidence des options possibles, des lignes de fuite, des tangentes, qui se pensent concrètement, philosophiquement, plastiquement à travers les arts, les temps, les époques, les contextes… Cette dimension concrète est importante car dans ma pratique scénique c’est précisément à ces manières ‘autres’ de tisser l’espace que je tente de donner forme, aussi bien dans l’aventure collective des théâtres, que dans le foisonnement des espaces urbains, aussi bien dans les lieux mainstream que dans les recoins les plus alternatifs, aussi bien en Europe que dans des contextes non européens. Et évidemment, dans le travail théorique qui nourrit obstinément cette pratique…
Or, des possibles, il en existe vraiment une multitude, souvent insoupçonnée ; du ‘scénographique’, on en trouve partout, bien au delà de son champ propre, tel que délimité en particulier [mais pas seulement] par la tradition théâtrale dont je suis issu, en Europe. Et dans ce livre, ce que je tenterais in fine de mettre en évidence, c’est la manière dont, pour des raisons à mon sens surtout idéologiques, [pouvoir(s), culture(s), sociales, politiques, esthétiques, institutionnelles…], cette pratique du mal à s’émanciper, à exister plus librement au delà de ses traditions, à s’hybrider dans des espaces d’imaginaire, de vie, d’énergie collective, de jouissance, vers lesquels ses potentialités et son avenir la poussent légitimement.
Ce cours, à Strasbourg, est depuis ses débuts une recherche du livre que je n’ai pas trouvé lors de mes études.
22/04/2019
Précision :
On pourrait penser que j’écris ces textes scénographiques ‘contre la scène’ ; la scène frontale en particulier. Or ce sont avant tout des explorations théoriques à résonance concrète (opérante) qui correspondent à une part de mon travail. L’endroit le plus avancé de cette recherche est l’espace urbain, via les Scénos Urbaines, le programme de recherche Play>Urban à la HEAR – tous deux avec François Duconseille. Cette recherche est aussi au coeur de la plupart de mes projets personnels d’artiste.
Mais simultanément je travaille très souvent sur des scènes frontales. Là, ce ‘scepticisme’ m’aide à entrer en tension, à ne pas considérer ces lieux comme naturels, à en interroger les rapports de pouvoir inscrits dans les murs – et souvent au sein les équipes qui les gèrent. Une manière de dialectiser la boite scénique, en particulier dans sa relation au public, à une époque où me semble t’il on est en pleine régression sur ce plan. Une manière de penser contre et avec dans un même mouvement, de ne pas nier l’importance centrale de ce dispositif tout en cherchant obstinément à le faire muter ; une ‘ruine agissante’, selon les termes d’Ann Laura Stoler. Ce n’est pas tant que je n’aime pas la scène frontale (ce serait même plutôt l’inverse, tant j’ai grandi et me suis rêvé scénographe avec elle dans les années 70-80), c’est plutôt que je ne suis pas sûr de son adéquation avec les formes du dire et du voir qui sont celles du monde d’aujourd’hui, et plus encore celles du monde à venir.
Et puis, via mes cours théoriques à la HEAR, Strasbourg (intitulés ‘Esquisses pour une histoire de l’espace de la représentation’) j’étudie depuis des années l’histoire des formes scéniques de manière approfondie. Et ce qui est passionnant c’est précisément le fait que l’on retrouve constamment ces enjeux, et ce depuis toujours ; et en particulier dans les avant gardes. Soit sous la forme d’une volonté d’intensifier la cage/grotte (et non la boite) scénique, soit en cherchant à s’en émanciper. Les deux mouvements vont de pair.
Ainsi, la grotte résiste, elle fait pivot. C’est de la boite qu’il est le plus urgent de s’éloigner.
20/04/2019
« Je m’intéresse à l’air de la chose qui échappe à l’encadrement – The air of the thing that escapes enframing is what I’m interested in. » Fred Moten
Petitesse et attention du geste d’artiste – scénographe. Ou comment disposer des choses sans découper ?
La place de l’éphémère dans ce geste. Disposer pour un temps bref, en immersion. Disposer sans inscrire, sans déplacer, ou à peine, ce qui est déjà là. Se glisser dans. Inscrire ou disposer, la bascule est ténue : « L’inscription est l’outil de la découpe. Une fois que quelque chose est défini contre ce qu’il n’est pas, ce ‘ce qu’il n’est pas’ est alors détaché de ce qui a été différencié (Inscription is the tool of cutting. Once something is defined against what it is not, that ‘what it is not’ is then ‘cut loose’ from that which has been differentiated) ».
Politique du scénographique : disposer sans découper. Légèrement déplacer. Intensifer sans forcément rendre visible. Une pratique faite d’attention aux espaces dans la ville, aux contextes : « une politique non-Euclidienne de petites et cependant régulières réalisations (a non-Euclidian politics of small yet continuous attainments) ». Un point de vue non unique, non directionnel au sens où dans un gradin classique tous sont invités à regarder dans la même direction. Un ensemble de sièges (colorés et de hauteurs variables) disposés par les personnes présentes comme bon leur semblera. Une invisibilité faite de visibilité car voir reste important. C’est comme dans l’expérience haptique, ou toucher-voir : voir ne disparait pas, il n’est simplement pas le sens premier, à part, au dessus, il fait partie d’un ensemble, avec les autres sens, le toucher, l’ouïe, l’odorat, j’ajouterais le mouvement…. La vision optique découpe, c’est une lame tranchante. L’invisibilité ne signifie pas ne rien voir, elle est un intervalle, un rythme du visible. Dont l’opacité fait partie. Ainsi les gradins-sièges serpentent dans l’espace, se glissent dans les recoins. Les corps performers focalisent l’attention, sans l’imposer. La direction du regard ne détermine pas une distance, porteuse d’une part considérable du sens. La distance ici est non métrique, mais dynamique. Un espace d’expérience commune se dessine, sans intermédiaire. Si je veux m’asseoir ailleurs, en contrepoint, je déplace mon siège et personne ne dira rien. Une politique non euclidienne de l’espace comme improvisation – disposer, déplacer, intensifier à l’intérieur de ce qui est là. Questions de rythme. La pièce, le geste artistique, performatif se joue au milieu de… et ce qu’il se passe autour ne s’arrête pas.
Je marche, je tourne la tête, j’oriente mon corps dans une direction et un instant, l’espace fait bribe de fiction (j’utilise ce terme en lien avec la possibilité de faire théâtre dans la ville). Chaque point de vue est un ‘flash dramaturgie’. Il s’estompe, je suis seul à l’avoir entrevu, et même (encore faut-il que j’y sois attentif)… Si je le sédimente, c’est le début d’une scénographie. Ainsi je peux s’installer partout. Il ne s’agit plus de différence entre réalité et fiction. Le binôme est inopérant. Quand je marche j’expérience autant de fiction, d’imaginaire que de réalité. Il ne s’agit plus de dessiner/écrire la scène dans un lieu ordinaire, dans la ville, dans une rue, une cour, en y superposant un espace fictif. Intensifier un espace, pour un instant, peut-être. Et encore. Ces distinctions sont embarrassantes ; l’imaginaire, la fiction, le réel, le sujet, l’objet, comme si mon regard le posait sur ce que je regarde. Mon regard, mon corps n’est-il pas plutôt enfoui, sous, dans, parmi… Pourquoi aurait-il cette puissance, ce pouvoir de se poser, de poser quelque chose sur ce qui l’entoure ? Faisant ainsi philtre, représentation ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une variation, d’une spirale ? Pour un moment. Une variation partagée.
Une politique des périphéries ? Constamment, la rue devient stade de foot à la nuit tombante. Ou mille autres usages. Cela nécessite agencement et improvisation ; ils sont constants dans la ville habitée par les gens. Y poser un geste artistique n’est qu’opérer un glissement parmi tant d’autres. Peut-être à peine plus visible, quoique. Même de cela je doute. A trop se montrer l’inscription perd son équilibre, s’impose. Poser un geste d’artiste ne dépend plus de sa visibilité et cette relative invisibilité n’empêche pas de le poser, au contraire. Une piste pour une politique des périphéries car ce sont les manières d’habiter l’espace (Julie Perrin : « la question de la pratique des lieux, d’un ‘faire avec l’espace’, une façon de produire des contre emplacements. Habiter est avant tout une action »), qui ici comptent, celles des gens, celles de ceux qui se débrouillent, ceux pour qui l’on ne construit pas la ville, ceux que l’on déplace et re-localise en fonction de besoins qui ne sont jamais les leurs. Ils savent cela et c’est à eux, immense majorité laissée sur le bord, qu’il convient de réfléchir à comment s’adresser.
Poser les choses, juste les poser.
Un ordinaire très beau – une grâce fugitive discrètement augmentée.
Ne pas construire des ‘théâtres’ avec toutes les contraintes techniques que cela génère et le contre sens éthique que cela contient.
Les citations sont d’AbdouMaliq Simone, Improvised lives, Polity press 2019. Et Julie Perrin, Figures de l’attention, Les presses du réel 2012, p. 252. Les traductions sont de moi.
13/01/2019
Pendant que les semi-remorques circulent plus que jamais entre un petit nombre de théâtres, je conçois et réalise de plus en plus de scénographies pour moins de 5000 euros. 5000 euros, c’est un seuil pour faire quelque chose, acheter un matériau ignifuge, poser un acte scénique en construisant un peu… Mais ce seuil est en train de sauter, il est de moins en moins souvent garanti. L’écart se creuse, un peu comme l’écart entre les plus riches et les plus pauvres. Mes deux dernières scénographies ont coûté autour de 1000 euros. Pour la prochaine, je ne sais pas, le montant n’est pas encore garanti. J’ai un beau plateau, mais transporter des éléments est presque hors de portée, j’aimerais ne pas être en frontal, mais cela fragilise les chances de tournée… Acheter un vidéo projecteur reste possible (les prix ont baissé), mais avoir de la vidéo sur un spectacle implique vite un régisseur supplémentaire… Tout, absolument tout, devient difficile à financer.
S’il y a un point – éthique – qui s’entend, c’est que devant la précarité grandissante (c’est peu dire) des productions, il vaut mieux financer des salaires qu’acheter du bois ou louer un camion. Je ne me plains pas, je travaille et j’ai la liberté de choisir les équipes artistiques auprès de qui je m’engage. Et puis souvent les spectacles tournent hors d’Europe, sur le continent africain notamment : on ne peut faire voyager que quelques valises ; on demande alors à chaque lieu de préparer des chaises, des tables, une moquette, quelques panneaux de bois, une palette de parpaings…
Il y a de plus en plus de chaises dans mes scénographies.
Ceci pourrait s’entendre comme un consentement à la précarisation, mais ces situations de créativité contrainte poussent de fait à une recherche de radicalité.Une donne nouvelle qui vient ? Qui signe peut-être la fin de ces décors avec lesquels j’ai grandi, que j’ai rêvé de construire en faisant le choix de devenir scénographe : ces visions scéniques pensées comme une découpe propre à un imaginaire, une situation, une dramaturgie. Cela reste une joie de replonger dans cette logique de la scène (Kristian Lupa récemment) et quelque chose de cette relation de la scène au monde persistera, mais autrement, plus parcimonieux, plus fragmenté, plus poreux, plus franchement traversé par du réel… Cependant, autre chose se devine (comme disait Barthes). La scène n’est elle-pas en train de devenir radicalement le lieu qu’elle est, soit un faisceau de sens, de pensée entre un public et des performers au coeur de laquelle de la fiction émerge.
Pour ma part cela passe par une recherche où tout élément est performé, activé par les corps ; par un travail sur des milieux scéniques qui défont autant qu’ils installent de la représentation. Les boites scéniques faites pour accueillir de gros dispositifs deviennent le dispositif. Je me prends à ne plus comprendre la présence d’un décor imposant. J’ai souvent le sentiment d’un déploiement inutile pour quelques effets visuels. L’évidence d’un élément scénique, sa force est en train de passer ailleurs. Dans son apparition, sa présence, son effacement… Comment presque rien produit des visions, une déflagration, du sens, inverse la proportion de la dépense et de l’effet. Je cherche aussi via la vidéo, de plus en plus, dans le dessin aussi. J’imagine la réserve de théâtres pleine de ce dont j’ai besoin et qui me serait mis à disposition dans chaque lieu. Je cherche aussi des contextes, des lieux et des manières de s’y inscrire…
La pensée, cela se voit.
Et se cherche ailleurs le devenir de la scénographie.
26/09/2018
Un extrait d’Edward Saïd, in Dans l’ombre de l’Occident, BlackJack éditions 2011.
« L’acte de représenter (et donc de réduire) implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation ; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme extérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, visuelle ou autre) du sujet. (…) il y a toujours ce contraste paradoxal entre la surface, qui semble être sous contrôle, et le processus qui la produit, celui-ci impliquant inévitablement quelques degrés de violence, de décontextualisation, de miniaturisation, etc. L’action et le processus de la représentation implique du contrôle, de l’accumulation, du confinement ; cela implique un certain type d’étrangement ou de désorientation de la part de celui qui représente ».
Ce texte me semble extrêmement parlant sur l’ambiguïté dont est porteuse aujourd’hui la pratique scénographique et théâtrale en général, du moins dans sa forme représentationnelle, telle que largement pratiquée en Europe. Il s’agit bien sûr de ce qu’Achille Mbembé appelle a pensée négative de la représentation (in Politiques de l’Inimitié), celle qui a à voir avec le passé colonial, et hégémonisant du monde occidental. Mais les propos de Saïd sont plus larges, c’est l’ensemble des pratiques représentationnelles qu’il interroge. Ce qui me trouble c’est que je ne vois guère où aujourd’hui en France, dans le champ du spectacle vivant (hors quand même la danse contemporaine), on entend parler du fait que l’acte de représenter est porteur de violence envers son sujet. De cette différence essentielle entre surface et processus qui conduirait à réellement déconstruire les espaces, les contextes, les assignations, la place des corps agissant et des corps percevant. Il y a certes des tentatives, mais où est la réflexion consistante sur le fait que la machine théâtrale est porteuse de cette violence, même sourde, même lointaine… J’ai au contraire le sentiment que ce sont des spectacles qui pleinement assument cette mécanique représentationnelle dans sa maîtrise, la puissance de ses effets, qui ont accès aux réseaux de visibilité mainstream.
Pour ma part ce sont ceux où je m’ennuie le plus.
Ce qui m’intrigue en fait, c’est que de telles recherches existent depuis longtemps, ont été hyper visibles et sont reconnues. Mais qu’actuellement elles sont bien peu considérées. Pourtant, par expérience, travailler en tant que scénographe à cet endroit, en creusant concrètement dans les outils spatiaux de la (re)présentation, en la mettant entre parenthèses, en l’affaiblissant, en interrogeant radicalement les gestes évoqués par Saïd (miniaturisation, décontextualisation, désorientation, violence – j’ajouterais découpe, cadre, frontalité, latéralité, invisibilité…), on accède à un large champ de possibles en termes de création et d’invention de commun : production de dissensus, relation entre sujet et objet (jusqu’à l’indifférenciation des deux), place des acteurs, formes de l’attention, déconstruction de la position de celui qui fait expérience… ces enjeux peuvent se travailler y compris dans les espaces les plus autoritaires, comme la boite noire frontale (ou la boite blanche du musée).
La (re)présentation devient alors la scène ouverte de jeux politiques. Et je ne développe pas ici, mais la question de l’échelle, de la réduction, est particulièrement féconde.
J’ai en fait l’impression que cette résistance, voire ce refus (moins dans les discours, que dans les actes) est une question de culture. Et quand le terme de culture arrive, les choses se compliquent. En clair, notre théâtre français (européen peut-être, occidental ?) serait ainsi et il existe une sorte de status quo tacite pour ne pas toucher, du moins dans la sphère mainstream, à quelque chose que l’on identifie comme naturel, comme évident, que tout le monde comprend et que l’on associe implicitement à des enjeux d’identité. C’est comme si à remettre trop en cause la représentation et ses outils, on allait perdre nos repères culturels.
Entendons nous bien, on peut travailler, on peut déconstruire, on peut altérer, ralentir, on peut décoloniser… mais on aura bien du mal à émerger.
15/09/2018
Kinshasa Chroniques
Sur une scénographie
020918
Je publie ici un texte écrit à l’occasion de la création de l’exposition Kinshasa Chroniques (vernissage le 23 octobre 2018 au MIAM à Sète), car il me semble faire partie de ces esquisses théoriques qui nourrissent avant tout ma pratique.
Kinshasa est une aporie. Une expérience intense pour qui y a été ou y a vécu, dont il est presque impossible de faire le récit à qui n’y a pas été. Une ville impossible à montrer, à raconter, à exposer. Multiples sont les incompréhensions, les mots n’y suffisent pas, les images non plus. Un trou noir, un mirage, un fantôme. Comment alors, à partir de quoi, envisager la scénographie, en France, d’une exposition, rassemblant plus de 70 artistes vivant ou ayant vécu à Kin.
Je ne peux pas simplement ‘représenter Kinshasa’ avec l’illusion problématique d’en donner une vision globale, sous la forme d’une scénographie d’exposition sans prendre en compte le fait que ce geste participe explicitement d’une forme de centralité réactualisée de l’Occident. Je suis européen et évidemment mon point de vue est façonné par une foi en la distance qui surplomberait ainsi que par un passé colonial auquel je ne peux échapper. J’ai certes vécu et travaillé longuement à Kin mais cela ne change pas grand chose, cela me rend juste, peut-être un peu attentif. Mes réflexes, le projet lui-même auquel je participe, en France, font question. Et la scénographie en tant que pratique opérant une mise en représentation, tout autant.
« L’acte de représenter (et donc de réduire) implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation ; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme extérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, visuelle ou autre) du sujet. (…) il y a toujours ce contraste paradoxal entre la surface, qui semble être sous contrôle, et le processus qui la produit, celui-ci impliquant inévitablement quelques degrés de violence, de décontextualisation, de miniaturisation, etc. L’action et le processus de la représentation implique du contrôle, de l’accumulation, du confinement ; cela implique un certain type d’étrangement ou de désorientation de la part de celui qui représente ». Edward Saïd.
Penser qu’on peut réellement échapper à cette ‘violence envers le sujet’ dont parle Saïd est illusoire. On est pris dedans. De la représentation surgira malgré tout, parce qu’elle fait partie d’un complexe de mise en forme du monde qui s’est diffusé partout au point d’être devenu diffus et invisible… à commencer par les habitudes du visiteur. Mais cela n’empêche pas de travailler à éloigner, à mettre entre parenthèse, en somme à affaiblir la (re)présentation, en multipliant les formes de présentation, un geste plus franc, plus direct (même si pas dépourvu d’ambiguïtés lui non plus). Comment avec l’espace comme matériau, faire glisser l’expérience du visiteur, quel(s) déplacement(s) opérer ? Saïd nomme avec précision certaines opérations à interroger : miniaturiser, décontextualiser, accumuler, confiner… J’ajouterais découper, cadrer, donner à voir dans un face à face avec le spectateur… Or ce sont justement les ‘outils’ de scénographe, des opérations que l’on mène constamment envers le sujet que l’on expose, quel qu’il soit. Il s’agit d’interroger l’évidence de ces opérations ‘naturelles’, que nous menons sans réfléchir à la violence qu’elles impliquent. C’est dans leur affaiblissement, leur déplacement qu’émergent peut-être, à ce stade, des possibles. Il n’est pas sûr que l’on puisse y échapper, mais il y a une nécessité à chercher ailleurs, un au-delà à explorer. Construire quelque chose de nouveau ? Cela donne souvent l’impression d’un mur à traverser car engager un tel pas de coté, même s’il ouvre aux possibles, laisse singulièrement démuni. On ne sait pas bien par où aller.
Pour l’expo Kinshasa Chroniques, deux pistes ont fait progressivement sens : l’espace est structuré par des couleurs. Elles sont à vrai dire le seul repère que nous donnons en les faisant correspondre à chacune des chroniques. Un travelling vidéo de Florent de la Tullaye dans les rues de Kin, où l’on voit que la couleur est le moyen principal qu’ont les gens pour donner une qualité au bâti, par ailleurs le plus souvent précaire, a permis un choix de rapports de couleur sur couleur, y compris dans les écritures. Cela résout plusieurs enjeux de lecture de l’exposition, mais cela passe par une opération d’abstraction qui peut faire question.
La linéarité de l’organisation de la ville, ses longues rues et avenues droites, sans fin (le schéma d’urbanisme de l’époque coloniale) m’avait marqué. C’est évidemment un peu dérisoire à l’échelle d’une exposition tant cette ville est immense et multiple, mais cela a fini par déterminer la disposition des cimaises. Cela permet d’éviter une scansion plus classique de l’espace destinée à guider le visiteur, faite de points forts, de mises en relations. Ici les lignes droites font que les parcours sont aussi peu imposés que l’espace le permet. Elles autorisent par endroits une errance, Elle permettent de matérialiser un double parcours, un espace-temps où l’on ne voit rien ou presque : une face des cimaises est ainsi laissée vide, simplement colorée. Cet face vide est une interrogation : il faut chercher les oeuvres, elles ne se donnent pas à voir si facilement. C’est sur l’autre face des cimaises qu’elles sont présentes dans une accumulation spatiale qui est plutôt juxtaposition, accumulation, que mise en dialogue : on plonge dans un foisonnement, une oeuvre n’est jamais visible seule, elle est en relation latérale, de biais, elliptique, avec l’ensemble de ce qui l’entoure.
Et il y a surtout les artistes et leurs oeuvres. La force de cette exposition, c’est qu’il y a 71 points de vue sur la ville de Kinshasa. Une multitude d’interstices inventifs apparaissent. C’est évidemment là que quelque chose de la ville se raconte et, pour le coup, se (re)présente. Le fait que cela vienne de regards d’artistes façonnés par cette ville change la dynamique des questionnements évoqués plus haut. Dans le contexte actuel, il y a une forme de légitimité dans leur point de vue qui leur permet assez librement de rejouer les conventions de la (re)présentation. Ils en ont été longtemps l’objet, ils en sont aujourd’hui les sujets. C’est évidemment eux qui ont des pistes à proposer, là où, je l’évoquais plus haut, souvent je tâtonne. Il serait évidemment possible de mettre le dispositif d’exposition en retrait, de ‘laisser parler les oeuvres’ comme on dit, mais il est autrement important d’essayer de donner forme, dans l’espace, à l’interrogation que constitue en bien des points ce geste d’exposer aujourd’hui, en France, dans le contexte d’un musée, ces artistes.
On échappera pas à la décontextualisation, à la miniaturisation, au confinement. Un espace très grand permettrait peut-être de produire une étendue où affleure la violence de l’opération de présentation, plus que la violence de ce que l’on présente (je pense ici aux multiples clichés sur les villes africaines et sur Kin en particulier). Où la découpe opérée par le fait que nous sommes dans un lieu fermé (un musée), s’atténuerait. Cela permettrait de dé-focaliser, de créer un vide qui fasse qu’en entrant on se perde en déambulant, on ne tombe pas directement sur les oeuvres, qu’il faille les chercher. On parviendrait, je pense, à défaire la mise en dialogue classique des oeuvres. Un grand espace permettrait des jeux de focale multiple pour un corps percevant en mouvement, des jeux d’intensité, d’accumulation, de juxtaposition, de décadrage, de brouillage, etc. Un parcours rendu par moments erratique, mais intense. Ou alors… inscrire les choses directement dans un contexte (ici Sète, plus tard Paris)… Rendre les oeuvres presque invisibles, dispersées, camouflées, fondues dans le lieu où elles sont montrées. Ainsi peut-être, Kinshasa deviendrait ce qu’elle est, vu d’ici… un mirage. Une idée, quelque chose dont on ne sait pas grand chose mais qui est malgré tout présent, via des gestes d’artistes, qui n’est pas confiné, qui traine, dans l’air, avec lequel on vit. Un fantôme qui se diffuse dans notre quotidien. Et peut-être ce fantôme ouvrirait-il des espaces de contact.
24/06/2017
La scénographie est une pratique difficile à cerner… Est-elle un métier ? Peut-on l’identifier comme tel ? S’inscrit-elle dans les champs de l’art, de la dramaturgie, du théâtre, de la technique, de la performance ? A trop vouloir s’affirmer artiste on vous renvoie technicien et constructeur. Souvent un metteur en scène, un théâtre, attend que vous régliez surtout les problèmes techniques. C’est là que votre ‘compétence’ est attendue. Il attend aussi que vos solutions soient simples, sans trop d’hésitations et de repentirs, qu’elles ne perturbent pas les conventions du lieu et les règles de la distance. Un syndicat (et quelques lieux), en France, tentent aujourd’hui de dicter les termes de ce qui est scénographique et de ce qui ne l’est pas. Mais leur rapport à la pratique scénographique est restreint. Il se fonde sur la prééminence du théâtre, plus précisément sur la boite scénique (avec en arrière plan la scène classique occidentale) et son fonctionnement en tant que dispositif d’expérience. Les pratiques plus ouvertes (espace urbain, exposition, variation du rapport scène salle…) existent mais comme des variations de ce dispositif fondateur qui définirait ce qu’est la scénographie. Du coup, les pratiques qui relèvent d’une théâtralité (inconsistante, disait Genet), d’une hybridation, notamment dans les multiples sphères de l’art contemporain, de la performance ou des sphères non occidentales, sont lues comme une perte de repères, une dévoiement, voire un pillage de la pratique théâtrale. Elles sont hors radar, invisibles, un bruit lointain et incompréhensible.
Or je crois qu’aujourd’hui, c’est précisément cette ‘inconsistance’ qui fait la force d’une pratique scénographique, dans un champ étendu, à la fois précis et diffus, qu’on peut appeler théâtralité, un champ poreux largement partagé dans des sphères très diverses de la création. Là, la pratique scenographique recoupe une large palette de possibles, mais ce fait n’est que rarement nommé comme sa richesse, même si dans les faits, c’est partout, massif.
Le terme ‘scénographie’ dans sa définition est occidental (Skene grafein, écrire/dessiner la scène). Il renvoie précisément à l’histoire du théâtre européen, mais ce théâtre et ses conventions n’est qu’un aspect de ce que j’appellerai un champ scénographique. Il conviendrait sérieusement d’interroger le terme lui-même dont les fondamentaux remontent jusque aux grecs et sont enchâssés au coeur de l’histoire de la représentation, de l’humanisme occidental et sa mise en pratique comme relation au monde via des régimes précis d’espace et d’image, des assignations du spectateur, des conventions, etc. Alors que nous vivons maintenant dans un monde multipolaire où la déconstruction de ces conventions est porteuse de politique : multiples sont ceux qui cherchent à déconstruire, partout, en Europe y compris… C’est dans la danse contemporaine que je trouve les questionnements les plus poussés, qui à la fois interrogent les espaces et les conventions de (re)présentation, mais aussi le rapport au corps et au spectateur. Et c’est dans les sphères non occidentales (notamment les chorégraphes et danseurs mais aussi, de plus en plus, la scène théâtrale du continent africain – je parle ici de ce que je connais le mieux, mais ce n’est évidemment pas propre au artistes ‘africains’) qu’ils me semblent les plus expérimentaux, ouverts, radicaux, libres et conscients en même temps. Ici, la pratique scénographique c’est aussi interroger la scène, le cadre, le signe, le texte, le spectateur, tenter des relations spatiales non découpées, non ‘dessinées’, non objectifiantes, plus rhizomatiques, à un contexte. La force de cette pratique c’est la mise en fiction d’un espace, c’est le corps agissant et percevant et cela est bien plus large que la seule pensée du théâtre occidental et de la scène. Ainsi nommée, la question scénographique est opérante, c’est à dire en prise sur les complexités du monde actuel.
Quand parlera t’on enfin sérieusement de scénographie ?
‘Reorganizing space by drawing through it’ (Gordon Matta Clark).
03/04/2017
Cesser cet entre soi du théâtre et des arts visuels, c’est aussi une question de spectateur, une question de scénographie. Une question de mutation des formats et des inscriptions dans l’espace.
Le moment que nous vivons est politique. Pour les pratiques artistiques cela veut dire une attention au monde qui ne passe pas que par les formats ‘classiques’ du dire ou du voir, mais aussi par une interrogation sur leur inscription dans l’espace, sur les formes de l’être ensemble. Dire cela et l’on s’entend répondre : oui, mais cela existe déjà, c’est une recherche ancienne. Peut-être, et après ! Pourquoi ne pas penser que c’est d’abord un potentiel d’invention, de création, que les possibles en termes d’inscription d’un geste plastique, théâtral dans un contexte – urbain en particulier [mais qu’est-ce que l’urbain aujourd’hui ?]- sont encore peu explorés, recèlent une immensité de possibles. Qu’il y a tout à inventer parce-que le monde change, parce que les urbanités mutent, parce que les espaces communs sont constamment à ré-inventer, parce que la scène ou la galerie comme références sont obsolètes [car séparées, coupées du contexte]. Et que du coup, c’est à l’immersion et à la porosité que s’ouvre la pensée spatiale, la réflexion sur les dispositifs. Quels espaces pour une écoute, une attention intense, précise, mais au coeur des flux. Et tant pis si c’est précaire, si c’est fragile, si c’est soumis à une tonne de contingences, à l’imprévu, à la pluie, au rendez-vous manqué, reporté, à la difficulté technique. Car si les gens viennent, s’ils sont là, s’ils agissent avec et autour, alors il se passe peut-être quelque chose, même si minuscule, modeste. Ce n’est pas juste l’artefact d’une performance à l’entrée de l’exposition, c’est l’intensification d’une pensée et d’une écriture du geste ou du visible, de sa capacité à se mettre au coeur des choses, à se confronter.
Ce n’est pas si difficile en fait, cela comporte moins de risques que l’on imagine. Par contre c’est éminemment politique au sens fort du terme, puisqu’il s’agit de créer de l’agir commun, ce qui est toujours inquiétant pour les pouvoirs en place. Et donc même si tout le monde en parle, je ne sais pas jusque à quel point c’est réellement souhaité. Pourtant, c’est peut-être aussi complémentaire avec les boites, les salles, les galeries, au sens où cette pensée de la porosité peut se déployer partout, même dans le plus classique des lieux. Alors pourquoi presque toutes les galeries qui s’installent à Belleville [Paris] finissent-elles par mettre un film translucide sur la vitrine… quand ce n’est pas une cloison.
A Medellin [projet Fictions ordinaires], la tentative est à cet endroit. Une expérimentation plastique, spatiale, théâtrale, inscrite au coeur d’un quartier, qui tente l’invention de situations, de relations, de moments, via un processus et une forme scénique, visuelle et sonore singulière. Pas forcément ‘nouvelle’, mais exigeante et en prise avec les gens, les habitants.
27/02/2017
La scène classique européenne est autoritaire, voyeuse, coloniale ; son dispositif, son origine, son histoire. Les usages négatifs de la représentation la hantent (zoo humain, mise en scène des ‘autres’, voyeurisme, etc.). S’il y a là quelque chose à nommer clairement (ces aspects sont si peu présents dans les études théâtrales) dans un contexte européen où nombreux sont ceux qui oublient que sa puissance de révolte, sa connexion au monde sont gangrénés de l’intérieur, que faire aujourd’hui de ce constat ? Prendre acte du fait que la scène classique, frontale, est devenue inutilisable, qu’elle objectifie, classe, ordonne, transforme aussi le corps regardé en objet d’un désir à sens unique… que le regard spectateur finit par se faire dévorant… que les fracas du monde restent dehors, coupés, distants, séparés… qu’elle se lit comme un tableau, tend à unifier la lecture, accepte mal la fragmentation… Pourquoi s’accroche t’on tant à cette sacro-sainte mise à distance réflexive qui n’existerait que devant un cadre (réel ou implicite) alors qu’il universalise et se fait machine à dévorer ? Ah, cette position assise vécue comme ‘évidente’, ce regarder = focaliser = penser, toute son attention sur un objet, une image composée et distante. Alors que cette forme d’attention est aujourd’hui largement obsolète.
Pourtant, cette dimension ‘coloniale’ est spectrale. Elle hante, sans vraiment empêcher : la scène – je glisse ici opportunément de la scène classique à la boite scénique dans son ensemble – est aussi un espace d’expérimentation, d’invention dont depuis longtemps – voir les avant gardes – les artistes s’emparent avec avidité et crainte pour mettre en jeu et en mouvement… Un espace dont ils rejouent, déconstruisent la tradition. Rebutés mais attirés par la puissance d’intensification de l’adresse et du dire qu’elle offre. Et la part négative de la représentation, ce passé qui la hante, est aussi une raison de cette attention : s’emparer de la scène pour se l’approprier et défaire de l’intérieur le colonial niché en elle, la pousser dans ses retranchements, mettre la (re)présentation à l’épreuve, faire glisser la relation au public, en somme se ré-emparer de ce qui fait sa force, l’être ensemble, la co-présence, le temps de la séance, la théâtralité…
Le plus souvent, ce dispositif, les usages qui en sont faits, me semble pourtant asséché. Le théâtre, la danse (un peu moins) que j’y vois reproduisent un mode d’expérience dominant sans en interroger les possibles et les recoins sombres. Les spectacles s’illusionnent sur la lecture du monde qu’ils proposent car en restant nichés confortablement au coeur de la boite, il oublient que nos modes d’expérience changent dans un monde qui change. Ainsi, n’être que spectateur assigné, m’emmerde. Je cherche plutôt à faire expérience dans un mouvement corporel proche et distant, avec d’autres, collectivement. Ce n’est pas contradictoire avec le besoin de distance. Mais il est difficile, au coeur de cette boite paradoxale, de matérialiser des interactions souples, de créer des ouvertures, des géométries plurielles et entrelacées. Je travaille dans des lieux souvent inadéquats avec des artistes, pour la plupart non-européens, que ce dispositif attire et que notre énergie commune essaye de bousculer. C’est tendu, ça frotte de partout, ça donne envie de s’échapper. La scène frontale – les gens qui la font fonctionner – résiste souvent, mais la boite scénique recèle des tangentes insoupçonnées. Il est possible de la faire vibrer en la retournant. C’est une recherche à la fois théorique et spatiale passionnante.
Le blocage est culturel, mais il va finir par lâcher.
Fevrier 2017 [A propos d’Antoine…]
Scénographie ? Sortir des cadres, géométries et habitudes stables du regard. De la convention de l’espace scénique comme milieu esthétique. Cesser d’[ab]user du vide de la boite noire. Radicaliser en ‘brouillant’ la position du spectateur, non frontale mais surtout asymétrique. Et puis, une série dense d’énigmes. La plus intrigante, un bloc – éclat, mobile au centre d’une aire de jeu tri-frontale et en biais. Opaque ? transparent ? Qu’il échappe aux codes de l’écriture ‘cohérente’, qu’il accumule à vue et aussi dans le secret d’une forêt une multitude de bribes, d’objets, de visions, de restes, de gestes, contradictoires. Pousser autant que possible vers un éclatement. Résister à la satisfaction esthétique de la cohérence visuelle contemplée à distance. Résister à l’idée d’un objet scénique non poreux avec le complexe, l’opaque, le fragmentaire qui nous entourent, à l’idée d’un objet esthétique lisible, qui dit, énonce comme un bloc irradiant et entier. Alors ! Inventer des espaces à trous, qui fuient et échappent, qui…, même si nous sommes dans cette bonne vieille boite scénique qui sépare et protège des bruits du dehors, qui se croit caisse de résonance. Eh bien, quand même, que ça rentre par tous les interstices du plancher, et du spectacle.
22/01/2017
Découpe. Ce qui m’interroge ce n’est pas tant la scène que la scène comme découpe, la nécessité de cet ‘enclos’ séparé, la boite scénique, ainsi que d’un cadrage pour faire scène. Je parle ici d’espace physique dédié à la représentation, du lieu théâtral toujours dominant, du moins en Europe (mais cette dominance s’est répandue partout et elle est souvent pire en tant qu’espace, hors d’Europe – scène haute, petite, peu profonde, cadrée, salle plate… bref, quasi inutilisable). On l’interroge peu souvent tant elle semble aller de soi, ou tant on se débrouille pour s’y adapter. Elle est pourtant au coeur de la question scénographique car sa configuration détermine l’expérience du spectateur. Or, aujourd’hui, je ne parviens que difficilement à faire exister les bruits du monde dans une telle séparation d’avec le monde. Tout semble devenir faux dans cette boite regardée à distance à travers ce qui reste malgré tout un trou de serrure. Cette découpe objectifie, elle transforme ce qui est sur scène en un objet qui n’existe que dans le regard intense d’un spectateur qui, ainsi placé, lit des signes certes, mais aussi jouit, dévore, s’approprie, juge… (oui, je sais… imagine, pense, se fait politique, dit-on). Il semble évident qu’il est besoin de cette opération d’écriture de signes dans une découpe, une page blanche ou noire, une boite, pour pouvoir représenter, que cette opération est au coeur de notre métier d’artiste de scène.
J’ai pour ma part l’impression que c’est dans une tension plus immédiate, plus concrète et plus lisible avec un contexte que je peux à la fois être attentif au geste scénique et en même temps rester en lien direct, en co-présence avec le monde dans laquelle il s’inscrit. Je suis ému par les hasards de l’urbain qui me semblent bien autre chose qu’un dérangement, une perte de concentration, par la manière dont ils téléscopent l’événement scénique. Dès qu’un lieu théâtral est poreux je me sens mieux. Une grande ouverture au fond, la possibilité de lumière naturelle… Alors le couteau est moins brutal. Oui, cette découpe m’ennuie et me pose problème, elle appauvrit ce que je vois et vis dans le temps d’une (re)présentation.
Les signes m’ennuient s’ils sont isolés.
Mais peut-être cette impression vient-elle aussi du fait que le spectateur n’est plus cette foule agitée et vivante que l’on voit par exemple sur les gravures du XVIII – XIXème siècle, ce temps où la salle était un condensé de la société.
12/01/2017
Spectateur 1.
Le spectateur existe t’il encore ?
Non, oui, parfois.
Cet individu ‘universel’, assis à distance, en face, dans la pénombre, bien séparé, regardant la scène.
La difficulté ici, c’est ‘bien séparé’. Comment faire autrement que ce ‘je suis assis là et je regarde’ assigné par le dispositif scène – salle ? Certes, je ne regarde pas qu’avec les yeux, certes c’est d’un regarder – penser – imaginer qu’il s’agit, peut-être d’un toucher-voir, mais quand même, je suis assis-assigné dans une immobilité et une primauté du regard par où passent les autres sens. C’est ainsi que mon corps se concentre. La lumière décroit, la salle fait silence, nous sommes dans une boite séparée du monde, le spectacle se passe sur la scène et je suis censé regarder avec attention, sans distraction. Vous allez vous demander ce qu’il me passe par la tête, tant regarder avec attention est une évidence, tant il semble naturel de ne pas être distrait, de se concentrer pour faire expérience. Sauf que mon voisin a mis du parfum, sauf que je m’agite, mon corps se rappelle à moi, sauf que je regarde les gens dans la salle, sauf que je somnole, sauf que… Même au delà de ces micro-circonstances, cet état, ce modèle d’expérience est tout sauf une évidence… Au spectacle je ne suis que par moments captivé, en fait, être absorbé est rare, de multiples écarts, instants de ‘distraction’ viennent se glisser, qui sont plus que des dérangements, qui font partie de l’expérience, qui sont un espace avec lequel travailler. En plus être absorbé est un état profondément solitaire. On m’objectera que l’expérience d’un public absorbé, captivé collectivement, est l’une des plus fortes qui soit, mais c’est aussi l’une des plus ambigüe qui soit et je ne suis pas sûr que X personnes faisant, dans un sentiment, un élan d’être ensemble cette expérience, fassent autre chose que l’expérience d’une fiction d’être ensemble (même si cela peut faire de gros dégâts).
Mais revenons à notre point de départ : séparé de la scène. Dans ce dispositif où le spectateur est séparé, assis, souvent en face, l’espace dicte ; je ne peux que prendre acte et accepter que c’est selon cette convention que le spectacle se déploie. Je ne peux construire une autre relation au public que marginalement : un acteur peut bien jouer dans la salle, croyant rompre la séparation, mais c’est à peu près tout. Si le spectateur existe encore, c’est peut-être simplement parce-que cette salle de théâtre existe encore. C’est peut-être parce-que là, séparé de la scène, tapi dans la pénombre qui favorise – dit-on – la concentration, la focalisation, il n’a guère le choix que de faire encore et encore cette expérience.
Jusque à quand ?
06/01/2017
Scénographie ? Sortir des cadres, géométries et habitudes stables du regard. De la convention de l’espace scénique comme milieu esthétique. Cesser d’[ab]user du vide de la boite noire. Radicaliser en brouillant la position du spectateur, non frontale mais surtout asymétrique. Et puis, une série dense d’énigmes. La plus intrigante, un bloc – éclat, mobile au centre d’une aire de jeu tri-fontale et en biais. Opaque ? transparent ? Qu’il échappe aux codes de l’écriture ‘cohérente’, qu’il accumule à vue et aussi dans le secret d’une forêt une multitude de bribes, d’objets, de visions, de restes, de gestes, contradictoires. Pousser autant que possible vers un éclatement. Résister à la satisfaction esthétique de la cohérence visuelle contemplée à distance. Résister à l’idée d’un objet scénique non poreux avec le complexe, l’opaque, le fragmentaire qui nous entourent, à l’idée d’un objet esthétique lisible, qui dit, énonce comme un bloc irradiant et entier. Alors ! Inventer des espaces à trous, qui fuient et échappent, qui…, même si nous sommes dans cette bonne vieille boite scénique qui sépare et protège des bruits du dehors, qui se croit caisse de résonance. Eh bien, quand même, que ça rentre par tous les interstices du plancher, et du spectacle.
18/12/2016
Ce qui me fait scénographe, c’est qu’on me raconte quelque chose… et alors je vois une image, un espace.
Ce n’est pas d’abord le théâtre, ce n’est pas la scène, c’est ce moment de la relation, c’est cette traduction.
Ce qui me fait scénographe, c’est que je vois un corps (dans son devenir fiction), un geste, une énergie, et j’imagine l’espace, la place de celui qui le regarde, un objet, une lumière, une matière…
07/2016
Il s’agit de rassembler des éléments sur un mur. Certains d’entre eux ont plus de dix ans. Le ruban ne colle plus. Un matin, vous vous concentrez sur ces morceaux de carton, de bois, de plastique, etc. Vous les réorganisez et ils deviennent le cœur de votre esprit. Tant d’options en eux. Certains sont là depuis longtemps et vous réalisez soudain qu’un projet en cours suit la même idée : un papier froissé suspendu avec des images dessus. Ces petites pièces fragiles sont des fragments d’un langage stable. Une sorte de grammaire mentale et physique.
09/2015
Un texte écrit pour les Scénos Urbaines Port au Prince 2015.
La théâtralité construit nos vies. Elle est processus d’intensification, d’isolation, d’infusion dans le flux du quotidien, multiple et bouillonnant de la ville : pratiques des gens chargées d’esthétique, d’agencements, de performatif, d’énergies. Il s’agit d’attirer l’attention.
La théâtralité n’est pas le théâtre, même si tous deux sont liés via notamment des mécanismes de mise à distance afin de penser, (théâtralité et théorie sont proches). Elle s’inscrit, souvent incomplète, fragile, « inconsistante, la théâtralité en somme », disait Jean Genet – dans le flux de nos vies. Elle n’a pas besoin de s’isoler, elle n’a pas besoin d’une scène, d’un cube noir ou blanc. Est elle cadrage ? Elle est mouvement des têtes, instant perçu, son qui nous parvient. Elle se perd dans une multitude de micro actions, de gestes fugaces, de tentatives d’apparaître. Nous les voyons, ou pas, cela dépend du hasard, de la distance, de notre point de vue, de notre présence. Ce qui se perd compte autant pour la texture de l’urbain que ce que nous attrapons, voyons.
La théâtralité façonne la ville : agencement des vitrines, rythme des pas, ‘show up’ de habillement (se montrer), présence des mondes invisibles, balancement de la marche en groupe ou isolé, proto-chorégraphie, tissu sonore… L’infra ordinaire dirait Georges Perec.
A Port au Prince elle est partout, extrêmement présente, souvent hyper visible, aussi bien dans le quotidien que lors d’événements singuliers. Cette ville est une puissante surface d’inscription esthétique, politique, performative, textuelle, fictive.
La question que nous nous posons lors de ces Scénos Urbaines est d’expérimenter des manières de créer avec la théâtralité de l’urbain. Comment faire performance, geste artistique et comment en s’inscrivant dans la ville, dans les rues, prendre en compte le contexte à nos projets, en particulier, surtout, les habitants. La singularité politique des Scénos est d’inventer des actes de création à destination de tous, sans avoir à les isoler dans un cube, qu’il soit blanc ou noir. Il s’agit d’aller au devant des publics, des gens, donc au coeur de la ville. Via des dispositifs d’intensification, des ralentissements ou des accélérations, la fabrication de figures, l’apparition de signes, d’objets, de corps, le déploiement d’actions, l’infusion d’idées, de gestes ; des processus de création partagés qui façonnent une expérience bien au delà d’une présence de spectateur. Une co-présence active où les rôles s’interchangent dans l’espace temps d’un geste de création. Qu’elle soit quasi invisible ou hyper visible, une performance collective, esthétique, sociale, mystique, politique, artistique.
Dans une porosité avec le contexte.
La théâtralité peut y aider.
Peut-on se passer d’une scène ?
Juillet 2015
Chroniques d’une révolution orpheline, sur le dispositif scénographique.
S’inscrire théâtralement dans une situation violente, changeante et complexe, qui se déroule sous nos yeux, à courte distance ?
Le texte de Mohammad Al Attar esquisse une forme de réponse : un dispositif textuel fondé sur le récit, le quotidien, l’intime, l’individu et l’humour. Il donne une série de pistes à explorer scéniquement.
Mais d’emblée la question me semble plus difficile – ou plus large, car elle oblige à prendre en compte le fait qu’aujourd’hui Daesh utilise le langage de la scène, du théâtre, littéralement, (voir l’utilisation du théâtre antique de Palmyre pour l’exécution spectaculaire d’un vingtaine de soldats il ya quelque semaines) pour mettre en scène des exécutions. L’histoire de la mise en scène, de la théâtralisation de la mort, des exécutions, n’est pas récente (l’échafaud, la guillotine, la pendaison – des noirs, etc.), mais elle est ici particulièrement frappante car les vidéos de Daesh utilisent jusque à l’obscène – et intentionnellement – des grammaires, des effets, qui sont ceux de la scène et du cinéma : le lieu théâtral et la grammaire du spectacle, nourrie notamment des clips vidéo, comme de la construction narrative des séries tv. Ces enjeux ne sont pas directement ceux du projet Attar, bien évidemment, mais l’on ne peut les oublier quand il s’agit de mettre en espace ses textes. Car c’est une possible obscénité du dispositif théâtral – et de la fiction – qui est ici mise en jeu pour qui veut bien consentir à le voir et à y réfléchir. Et cette obscénité n’est pas absente de l’histoire même du théâtre. ‘On ne peut les oublier’ veut dire ici que cela nous oblige à nous questionner sur le dispositif scénique de ce spectacle. La représentation de tels enjeux – ici la guerre en Syrie, la torture, la mort – ne devrait-elle pas évoluer à la fois sur le plan éthique, mais aussi, sur le plan des formes esthétiques et artistiques. Il ne s’agit pas de faire spectacle, ni même peut-être de faire (re)présentation ; ou peut-être si… s’il s’agit malgré tout de faire représentation (peut-on y échapper ?), comment faire ? D’une manière qui en interroge constamment le dispositif, d’une manière qui tente de donner des visions singulières et créatrices de ces enjeux, y compris peut-être sans avoir peur du spectacle. Je pense ici à des discussions avec Steven Cohen qui travaille constamment, avec son corps, dans une attention toute particulière à la beauté, à l’esthétique, à inventer des formes contemporaines et nouvelles de parler de la Shoah, à en questionner les esthétiques acquises, dans une claire volonté de faire choc, de faire émotion, de faire réflexion.
C’est ce qui m’intéresse dans le projet Attar : Inventer un dispositif scénique et esthétique qui travaille – modestement – à cet endroit. Les textes d’Attar y aident, ils refusent le spectaculaire, ils suggèrent des dispositifs de prise de parole très simples. Mais ils ne nient pas la nécessité du visible, du visuel (le road-movie). Par contre ils en ‘cadrent’ les enjeux. Il y a aussi quelque chose d’une pluralité de points de vue qui s’exprime, parmi les figures traversant ces textes comme dans le choix de Leyla Rabih d’articuler trois textes ensemble afin d’en faire un objet spectaculaire. Je souhaite accentuer cette pluralité en proposant dans un dispositif d’espace commun, contextuel en fonction des lieux théâtraux ou non théâtraux dans lesquels nous jouerons, plusieurs dispositifs : ceux des trois textes, soit un échange de mails, une interview et un road-movie (tous trois suggèrent une sortie de la scène, même s’ils sont écrits pour la scène) ; mais aussi ceux que proposeront les participants au projet, et en particulier des artistes syriens invités : une projection de dessins, une vidéo, un moment.. Tous seront construits à partir des textes d’Attar, mais ne chercheront pas forcément un propos dramaturgique unique. Ils fonctionneront selon un principe de variation autour d’un noyau, les textes, et la mise en scène de Leyla Rabih.
Jean-Christophe Lanquetin
Textes écrits en septembre 2014.
1.
S’il est un constat que je fais de plus en plus souvent au fil de mes voyages, c’est celui d’un monde en mutation accélérée, devenu globalisé, dans lequel nous vivons tous, un monde qui n’aurait plus de « dehors », d’extérieur. Le sentiment d’altérité, de radicale différence que j’ai pu longtemps avoir s’estompe au profit d’une plus grande familiarité, de similitudes grandissantes dans la manière dont les personnes que je croise et les villes où je vis évoluent. Cela influence la manière dont je me positionne là où je suis : n’y aurait-il plus d’« autres », au sens de ce « nous et les autres » qui a fondé les représentations sur lesquelles s’est construit le monde occidental d’où je viens ? Pour qui est né en France dans les années soixante, cela ferait-il qu’enfin je serais un peu moins à la fois le représentant d’une histoire pas toujours simple à porter et simultanément un étranger dans les villes où je passe du temps et où j’interviens en tant qu’artiste ? Le fait que par delà les continents, les histoires, les cultures, le monde semble devenir un peu moins marqué par des logiques de la différence, m’ouvrirait-il la possibilité d’interroger ce que je vois, où que je sois, dans une relation de proximité fondée sur l’idée que l’ailleurs est aussi mon proche.
La notion de commun m’intéresse car elle formule l’existence d’un espace dans lequel je peux me projeter : « est commun ce à quoi tous ont accès parce qu’ils contribuent sans fin à le réinventer et à l’augmenter ». Cela renvoie à l’idée qu’il y a des choses fondamentales communes à tous, l’air, le vide, l’espace, mais surtout les pratiques d’interaction sociales, culturelles, économiques, etc. par delà la diversité, la singularité des formes qu’elles prennent. Or ce qui m’a toujours attiré, aussi bien au théâtre que dans la ville, a à voir précisément avec ce commun et les espaces qu’il ouvre : « (…) des espaces immenses de subjectivation, d’invention, d’expérimentation : nous voulons élaborer de nouveaux modes de vie, nous voulons creuser dans les mailles de notre propre présent une prolifération de différences possibles, nous voulons faire circuler, traduire et trahir, utiliser et réinvestir, emprunter, citer, tordre, translater, sauter par dessus les frontières des nations et des langues, des religions et des cultures – agencer dirait Deleuze. ». Ces actes et agencements multiples, improvisations, performances, tactiques, présents partout, avec leur énergie, leur dimension de fiction, leur théâtralité, participent de la manière dont les gens pratiquent, créent et résistent. façonnent leurs espaces afin de pouvoir y vivre de la manière qu’ils souhaitent.
Intervenir à l’échelle des corps (performers, participants, spectateurs, habitants) est ma manière d’interroger les dynamiques et tensions du monde que je parcours. Via en particulier l’espace et la photographie, il s’agit de construire des situations communes avec les gens, qu’elles soient d’ordre performatif, théâtrales, chorégraphiques, ou qu’il s’agisse d’installations dans la ville. Je tente de m’inscrire dans des contextes et de raconter, seul ou avec d’autres, des situations qui renvoient aux tensions générées par le passé – colonial notamment – et par la mutation accélérée du monde. Que je mène une ‘enquête visuelle’ subjective dans une ville et la contextualise sous la forme de dispositifs/récits dans l’espace urbain ou que je travaille avec un chorégraphe pour un projet scénique, la dynamique est fondamentalement la même. Des installations à dimension performative qui ouvrent momentanément un espace commun, qu’il soit urbain ou scénique, le temps d’un événement. Des ‘scènes’.
Je suis dans une position d’ ‘outsider’. Le théâtre est mon background, mais j’ai toujours privilégié une position diagonale, qui questionne dialogiquement les conventions, les cadres, les habitudes (l’ancrage de la scénographie dans l’histoire visuelle et la pensée occidentale). Les espaces, les présences que j’invente se nourrissent de cette position qui est aussi mon vécu lorsque je suis à l’étranger. Si je me sens de moins en moins autre, cette position persiste. Penser qu’il peut en être autrement est probablement un leurre, même si certaines villes après de multiples séjours me deviennent familières. Mais on finit par s’apercevoir qu’elle est intéressante. C’est un entre deux, un sentiment de non appartenance, je ne suis pas chez moi et pourtant, je ne suis pas un étranger. En flottement, en ‘chute libre’ dit Hito Steyerl. Danger ? Perte de repères ? Liberté surtout. Cela donne une distance pour observer. Une position d’outsider proche m’intéresse : passer du temps dans un endroit, en partir, y revenir. Une part importante de ma présence en ce monde se construit ainsi. Ce ‘flottement’ n’est pas une présence en transit – vu d’un hall d’aéroport -, Ces temps de vécu sont le point de départ de projets. L’œil, le corps se mettent en travail d’une manière à la fois ancrée et libre. « L’habitude est le commun en pratique ». On perçoit, on échange, on formule, on questionne.
Il s’agit aussi de la manière dont ma présence est perçue et acceptée, ou pas. Cela va d’une complète indifférence à une extrême attention envers mon corps, mes gestes, mes mots. En Europe je suis habitué à être fondu dans la masse, flâneur construisant un regard cinématographique sur ce qui m’entoure. Ailleurs, le corps, la peau deviennent hyper visibles, une surface de projection biopolitique, historique. Cette tension m’amène à construire certains projets autour de ma présence physique, manière de jouer avec les projections que je suscite et les déterminismes dont je suis porteur. Il s’est agi longtemps d’une présence discrète, refusant une place centrale (celle du metteur en scène), mais non absente afin de rendre lisible le pourquoi des actes posés. Mais de plus en plus malgré la timidité, je m’intéresse à une mise en performance assumant plus clairement cette dimension biopolitique.
Les citations sont extraites de Commonwealth, de Toni Negri et Michael Hardt.
2.
What could be a contemporary concept of scenography?
What i’m interested in is relation. I came to think it’s almost impossible to know what people experience through/during a performance. Even the words they use when they come to speak about it can be far from any idea. Even if the audience’s experience remains inaccessible as linked to each singular person, the spatial conditions a scenographer/artist create for a performance are essential to such an experience. In this approach, the western tradition of theatrical space becomes cumbersome. We have constantly to adapt to a place which is already framing the terms of the relation between the audience as a group and the stage. And in a remaining and powerful way. I often think the fight is unequal (which appears in some projects); but acknowledging what appears in terms of performative practices over the world and questioning the evidences of an established tradition is a way to open a space (particularly for theater); this requires to articulate a theoretical process with practice.
In my experience, scenography is not only a continuation of the western theatrical tradition of stage and it’s rules, including the distant relation to an audience in the frame of the classical viewer’s dispositif and the persistence of the decor. Scenography is a matter of space for fiction in a larger way – maybe just a space emphasizing fiction: from optic to haptic, from spectacular to invisible, with or without ‘cutting’ (découpage) – how to define/build a stage?-, from theater to theatricality. And particularly what about representation in a practice which is highly representational, but where the question of deconstructing the dispositif of representation is constantly and strongly on the table.
The point of tension, of questions, in my work refers to and includes the theatrical tradition I come from, but in a dialogic approach. A core point is not the body of the performer but the body of the audience (individual, collective?). The political is the work on the position and conditions of an audience point of view/experience in a space, a context, a place – often urban, in my practice; and of course the way the performers (actors, dancers, artists…) – the performance at large – build a relation with the people experiencing it whether they came specifically for it or they are passers by in a street. In my work I particularly focus on the imbalance of power – the authoritarian dimension in the history of spectatorship – and on what I could call an emancipating dimension, a spatial research on the possibility of a performative experience which is not framing what you (must) see, which is giving anyone the possibility to choose a way to experience.
Shifting in such a way the notion of scenography is related to a large body of practice, encounters, experimentations and to the fact I work extensively in non western countries where contemporary artists and performers deal with this notion of stage – they often don’t feel comfortable with it-, theater and performative arts in a larger way, unpack it. They don’t necessarily focus on the tradition of scenography. Or just as one aspect, among others.
To be continued.
3.
On photo works
1. My photographic works are mostly on contemporary cities as a major ongoing banal ‘theater of operations’ over the world. I particularly focus on the production of the ‘common’, a battlefield between the massive dynamics of urbanization driven mostly by authoritarian ultra liberal mechanisms, and the multiplicity and singularity of horizontal practices by people in the ordinary city. Between privatization, segregation and the multiple ways peoples occupy, convert, live in, experiment – small experimentations – city spaces.
2. The ‘common’ here is of course the common spaces but in a larger way, what do people share in contemporary cities. « By ‘the common’ we mean, first of all, the common wealth of the material world – the air, the water, the fruits of the soil, and all nature’s bounty – which in classic European political texts is often claimed to be the inheritance of humanity as a whole, to be shared together. We consider the common also and more significantly those results of social production that are necessary for social interaction and further production, such as knowledges, languages, codes, informations, affects, and so forth. This notion of the common does not position humanity separate from nature, as either its exploiter or its custodian, but focuses rather on the practices of interaction, care, and cohabitation in a common world, promoting the beneficial and limiting the detrimental forms of the common. In the era of globalization, issues of the maintenance, production, and distribution of the common in both these sense and in both ecological and socioeconomic frameworks become increasingly central« . Toni Negri, Michael Hardt, Commonwealth, Preface.
3. The series are like questions. While I travel in various places over the world I see things, and they become series of pictures. The ‘common’ world in which we all live is a clear scale in my work. Each series is like a question mark on how ‘urban works’ gets done. My intention is to pin, to wonder, not to judge. It goes also into a dimension of fiction. And of course, it relates to my own subjectivity.
4. I always felt embarrassed with the fact of taking pictures of people. I no longer take pictures of people’s face if they don’t agree on it. I don’t know where it takes me conceptually but the dimension of a camera as a ‘gun’, is maybe one of the reasons why I began late to process in photography. I focus on empty spaces/places. If people are in the picture, they are far, or from behind. Or they clearly agree. In the Belleville project I decided to put a white circle on people’s face. These questions are really in process at the moment.
5. The photos I take are (like) a ‘stage’, a temporary space/time for people to experience, speak (or not), play with what they see, to reflect and address words, stories, desires, memories, practices. The photos I take become a stage as soon as they are exhibited. An encounter, a space for a ‘rendez vous’ whose effects are not necessarily the one I expect – a space for dissensus and relation -. The photos open a latent space. An event. It is of importance photo installations to be exhibited in the urban spaces – contexts – where I took them.
————————————————–
fragments about my time in New Delhi 2011, during a workshop at the Gati Dance Forum.
Theatrical places ?
The question of theatrical spaces arises. As usual, I could say !
What could be a theatrical space for such a project here in New Delhi ? Certainely not the caricature of classical theater where they will perfom. The space in itself is ok, quite large, but old, and moreover, is it appropriate to a reflexion on space, as it is based on the classical european principle. As if theater was only this all over the world !
In the first two days, I see two others spaces who are immediately for me questionning this.
Jantar Mantar and a little mosque in Lodi garden. The question is not to be local or whatever (even though I think and expericence when travelling the differences of spaces – physicality, forms… – in different places over the world), but interrogate why an european standard became so universal, as « THE theater place », and why is it still so difficult to think in a larger way about theatrality, which does exist everywhere in terms of space.
But maybe the Lodi mosque and Jantar Mantar are too obvious options, in their way to be related to past and religion. Maybe, simply we should design spaces in the city, in urban space, as a way to play with the question of public space.
Jantar Mantar, a theatrical place ?
Reading Katia Legeret (p.55) about nta (ritual) : regularity, rule and adherence (régularité, règle et adhésion). The first one is based on the macrocosm, for instance the observation of the regularity of astronomical phenomenon : the second one is about mesocosm, the institutions of a society and the third is about microcosm, the deep adherence of hart and soul and the faith in the person. (…) Accomplishing a ritual is about assuming the cohesion and interdependency of these three worlds. (…) The dancer-actor has in particular to dissolve himself as an individual and rebuild himself as an analogy with the elements of the nature and the universe.
See also : René Daumal, Bharata p88.
How to work with such a space, as the astronomical dimension appears in the texts about ancient indian theater.